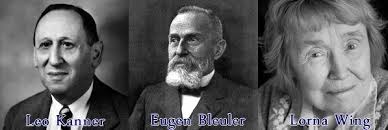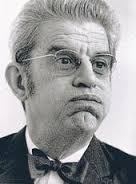Accueil > Politique de l’autisme > Adresse à Madame Ségolène Neuville, Secrétaire d’État aux personnes (…)
 Adresse à Madame Ségolène Neuville, Secrétaire d’État aux personnes handicapées. Après son discours au Comité National Autisme du 16 avril 2015
Adresse à Madame Ségolène Neuville, Secrétaire d’État aux personnes handicapées. Après son discours au Comité National Autisme du 16 avril 2015
vendredi 17 avril 2015, par
Communiqué de presse du RAHHP
Adresse à Madame Ségolène Neuville,
Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées
Après son discours au Comité National Autisme du 16 avril 2015
Madame la Secrétaire d’État,
Vous avez le souci de l’argent du contribuable et de la qualité des interventions qui sont financées par les pouvoirs publics, et nous vous en sommes reconnaissants.
Vous souhaitez vous appuyer sur des preuves scientifiques pour orienter votre politique, et ce souci de rigueur vous honore.
Cependant, je tenais à vous alerter sur le fait que, concernant la question de l’autisme,
- la HAS * n’a pu accorder à aucune méthode le niveau de preuve de grade A, ce qui signifie qu’elle reconnaît l’absence de preuve scientifique de l’efficacité des différents modes de prise en charge.
- Une recommandation n’est pas une norme, ni une obligation. C’est une aide à la décision pour le médecin.
- En aucun cas ces recommandations ne sont opposables. C’est contraire à leur principe.
- Vouloir empêcher la pluralité des formations est contraire à l’esprit de la république et à la loi.
Nous tenons par conséquent à soutenir la nécessité d’une approche plurielle des autismes, car les étiologies autant que les formes cliniques sont multiples, et il ne paraît pas rationnel de proposer une méthode unique pour des affections aussi variées.
Ce qui apparaît ici comme un conflit entre méthodes ou entre positions idéologiques ne doit pas voiler le fait que ce que nous avons à défendre en commun, en tant qu’associations de familles, c’est avant tout la création d’un nombre suffisant de places pour accueillir nos enfants, les aider à devenir adultes, et savoir qu’ils seront accueillis lorsque nous ne serons plus là pour les protéger. Le principal retard de la France se situe à ce niveau.
Nous sommes d’ailleurs rattrapés sur ce plan par le Québec qui a tout investi dans les méthodes que vous voulez rendre exclusives, au détriment des autres mesures, pensant qu’il y aurait beaucoup moins d’adultes dépendants grâce à cette technique. Il se trouve obligé de constater qu’il n’en est rien, et le manque de places et de prise en charge pour personnes autistes dépendantes se fait cruellement sentir, chez eux aussi !
En effet, nous attirons votre attention sur le fait que dans les pays que vous prenez pour modèles et qui pratiquent depuis 40 ans ces méthodes, les études indiquent que le nombre de personnes autistes adultes dépendantes est équivalent à ce que nous constatons chez nous.
De même, lors de la journée parlementaire sur l’autisme du 8 avril dernier, Monsieur Marc Bourquin, directeur du pôle médico-social de l’ARS d’Ile de France, a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve qu’un accompagnement intensif cognitivo-comportemental très jeune permette de faire des économies par la suite.
Nous attendons avec intérêt une décision de votre part d’évaluer ce qu’il en est réellement de l’efficacité des 28 centres expérimentaux ABA mis en place voici plusieurs années déjà avec l’argent public, et faisons remarquer que dans les études sur l’ABA pratiquées jusqu’ici, le groupe témoin n’a jamais été suffisamment défini et, qu’en particulier, ces études n’ont jamais comparé leur efficacité à celle d’une prise en charge plurielle telle qu’elle est pratiquée dans d’autres établissements de notre pays.
De notre côté, nous pouvons d’ores et déjà dire que des études scientifiques sont en cours en France, visant à évaluer la pertinence d’autres approches, et que nous avons de bonnes raisons d’espérer prochainement des résultats intéressants qui obtiendront un niveau de preuve suffisant pour qu’elles soient recommandées.
Enfin, la HAS n’a pas du tout, en 2012, mis l’accent sur l’inclusion*. Doit-on laisser tomber cette revendication ?
Elle a discrédité TEACCH en lui conférant un grade C : doit-on interdire les pictogrammes ou couper le financement des établissements qui les utilisent ?
Comment traite-t-on de la violence par les méthodes cognitivo-comportementales ? Il n’existe aucune étude scientifique sur ce point crucial et fréquent.
Est-il nécessaire de rappeler que dans la classification NICE, équivalent de la HAS au Royaume Uni, la méthode dont vous voudriez imposer l’exclusivité n’est pas même mentionnée.
Doit-on faire remarquer que Laurent Mottron, avec l’expérience de 15 ans de pratique ABA au Québec, nous met en garde et nous déconseille de nous engager dans cette voie ? Serait-ce déjà une méthode obsolète ?
Nous sommes bien placés, nous parents pour savoir qu’en matière d’autisme, il faut inventer tous les jours, et que ce n’est pas toujours compatible avec une démarche hyper-protocolisée. Nous souhaitons donc maintenir la porte ouverte à toute possibilité d’invention et de recherche, afin d’offrir à nos enfants tout ce qui peut leur permettre de progresser et d’apporter leur propre singularité à la richesse de l’humanité.
Christine Gintz
Secrétaire Générale du RAAHP
(Rassemblement Pour une Approche des Autismes Humaniste et Plurielle), Association régie par la loi de 1901
Contact : leRAAHP gmail.com
Site ; http://www.raahp.org/
Voir aussi : Lettre ouverte à Madame Ségolène Neuville, par Daniel Roy, secrétaire de l’Institut de l’Enfant.
Lexique
– HAS : la Haute Autorité de Santé a sorti en mars 2012 des recommandations de bonnes pratiques pour les enfants et adolescents autistes qui ont suscité de violentes polémiques.
En effet l’approche psychanalytique de l’autisme y était présentée comme « non prouvée scientifiquement » et « non consensuelle » alors qu’une méthode cognivo-comportementale, l’ABA, basée sur le conditionnement opérant, y recevait un traitement de faveur.
Jusqu’à ce jour aucune des nombreuses recommandations de la HAS dans tous les domaines de la santé n’avait eu force de loi. Utiliser la HAS pour tenter de légitimer des choix idéologiques et politiques est contraire au droit et discrédite cette Haute Autorité.
La décision de refuser d’accorder un agrément (ou même de le retirer) aux organismes de formation qui ne diffuseraient pas exclusivement cette méthode controversée, ou encore la menace de ne plus financer les établissements récalcitrants, sont autant d’atteintes graves aux libertés de pensée, d’expression et de la recherche.
– L’inclusion : au contraire de l’intégration qui vise à ce que des personnes en marge de la société évoluent et s’adaptent pour y trouver leur place, une politique d’inclusion vise à transformer la société pour que ces personnes, quelles que soient leur difficultés, puissent avoir accès à toutes les sphères de la société : école, emploi, transports, culture, etc.
La loi de 2005, qui rendait opposable le droit pour tout enfant à être scolarisé dans l’école publique de son secteur, a été la première grande réforme en faveur de l’inclusion.
Depuis 2 ans ce thème a pris une place centrale dans les discours sur le handicap, ce qui n’était pas encore le cas au moment de la rédaction des recommandations de 2012.
 Écouter les autistes
Écouter les autistes