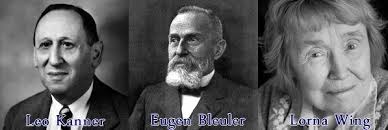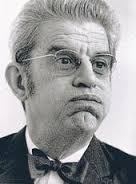Accueil > Politique de l’autisme > L’autiste créateur : ni Golem, ni vide !
 L’autiste créateur : ni Golem, ni vide !
L’autiste créateur : ni Golem, ni vide !
jeudi 6 mars 2014, par
Dans un article daté du 21 février dernier, publié dans le journal Le télégramme sous le titre « Autisme. Un plan catastrophique » [1], Charles Melman, psychanalyste, co-fondateur de l’ALI, réagit dans une interview au troisième plan contre l’Autisme, entraînant plusieurs réactions d’élus, de professionnels de santé et d’associations proches des familles en Bretagne [2].
Son propos commence par quelques dénonciations pertinentes de la politique gouvernementale avant de virer à des considérations désolantes sur la subjectivité autistique.
Il y dénonce le fait que la question de l’autisme, relevant autrefois du Ministère de la Santé, soit confiée à Madame la ministre déléguée aux Personnes handicapées, en se basant sur l’hypothèse que l’autisme est lié à une anomalie génétique, en conséquence de quoi, nous dit-il, les bébés diagnostiqués « autistes » sont « condamnés à l’assistanat à vie ».
En effet, le gouvernement, par l’entremise de Marie-Arlette Carlotti suit ainsi à la lettre les méthodes recommandées par la HAS pour le traitement de l’autisme, qui pour s’être rendue aux vertus supposées de l’évaluation scientiste, l’ont amené à privilégier les techniques cognitivo-comportementales [3].
Ces recommandations sont pourtant loin d’être validées scientifiquement, puisque dans le meilleur des cas elles ne recueillent qu’« une présomption scientifique d’efficacité » voire « un faible niveau de preuve ». Ainsi, l’autiste du fait de ce nouveau statut d’handicapé, devra compenser son déficit en bénéficiant d’une rééducation inspirée de telles méthodes dont les résultats sont incertains, et qui pour être obtenus ne répugnent pas à utiliser la contrainte, comme le fait la méthode ABA.
Selon Melman, le maintien de la question de l’autisme dans le giron du Ministère de la Santé aurait eu pour effet de faciliter le dépistage précoce des nouveau-nés qui pourraient alors être confiés plus rapidement à des spécialistes, et notamment des psychanalystes.
Nous ne pouvons que souscrire à cette proposition bien que la clinique en institution montre que ces spécialistes sont plus souvent des pédiatres que des psychanalystes, avec des abords médicaux éclectiques. Il faut encore préciser la nécessité de « laisser libre cours à la diversité des approches et des recherches dans ce champ à condition qu’elle fasse confiance aux inventions des autistes, aussi minimes soient-elles », comme le promeut le « Collectif Autisme » [4].
Si Charles Melman nous rappelle en introduction de son article qu’il n’y a toujours « aucun argument scientifique et médical probant » à l’appui d’une étiologie génétique de l’autisme et qu’elle reste donc inconnue à ce jour, il nous apprend cependant - à notre grand étonnement - que les psychanalystes seraient « susceptibles de traiter le bébé de 3 à 18 mois avant que le développement neuronal vienne fixer le défaut de croissance de circuits qui n’ont pas encore été établis ».
Son optimisme sur les capacités des psychanalystes à « restaurer les circuits neuronaux précoces » dérive vraisemblablement d’une thèse soutenue par le groupe de recherche PREAUT [5] sur l’importance de la « prosodie du mamanais », résultat d’une étude à partir de films visant le dépistage des signes précoces d’autisme et en référence à l’hypothèse d’une absence du troisième temps de la pulsion, dite « invoquante ».
Si ces recherches ne manquent pas d’intérêt, les conclusions qu’il en tire sont excessives. Marie-Christine Laznik, psychanalyste membre de l’ALI et co-fondatrice de l’association PREAUT, constate elle-même que le déficit de « mamanais » ne peut expliquer l’autisme : un refus du sujet précède.
Les travaux de Jean-Claude Maleval montrent en effet un refus des sujets autistes à céder leur voix : ils ont peur du vide auquel les confronte l’appel à l’Autre. Ce refus de l’enfant à se mettre en position d’énonciation, qu’a pu constater Anne Idoux-Thivet [6], mère d’enfant autiste, l’a amené à se décaler de cette attente, et à reprendre la musicalité de la langue de son fils en chantant avec lui. Loin d’être vide, ces enfants nous enseignent comment ils tentent de se protéger du langage qui peut les persécuter.
Pour Melman, la cause de l’autisme est très simple. La mère de l’enfant autiste n’aurait « pas pu transmettre le sentiment de cadeau qu’il était pour elle ». Or, s’il comprend bien, comme il le fait remarquer, qu’un certain discours mettant en cause « le comportement maternel » heurte les familles, et qu’il prend le soin de préciser que la mère peut être « fort aimante au demeurant », celle-ci se trouve néanmoins frappée d’impuissance, et dès lors responsable de l’autisme de son enfant, celui-ci n’ayant pas pu trouver place dans le discours maternel.
Mais l’auteur de ces propos culpabilisants et qui méconnaît « l’insondable décision de l’être » [7] décelée par Lacan, ne s’arrête pas là… Le père a aussi sa part, puisqu’il donne pour exemple que si ce dernier venait à décéder quelques temps avant la naissance, le deuil de son mari par la mère l’empêcherait d’accueillir avec bonheur son nouvel enfant.
Or comme le rappelle Pierre-Gilles Guéguen, il est important de « ne pas considérer systématiquement qu’il y a une causalité psychique entre la façon dont un enfant a été éduqué par ses parents, et l’état dans lequel il peut se trouver. Il faut bien admettre que c’est contingent, qu’on ne sait pas ce qui a pu produire ça pour un sujet, avant que le sujet lui-même puisse en faire état » [8].
Pour finir, l’interviewé dit des enfants autistes qu’ils « sont vides comme un golem au sens où leur capacité combinatoire n’a pas de maître ni de limites » et qu’ils « ont des capacités de calcul souvent stériles, comme un ordinateur laissé à lui-même. Il n’y a pas d’instance morale ni réflexive venant leur donner une identité ».
Ces propos sont insultants et diffamants pour les personnes autistes. Ils démontrent une méconnaissance profonde de la clinique autistique. Ce qui est énoncé dans cet article va à l’encontre des études entreprises très tôt par Rosine et Robert Lefort [9] concernant les témoignages d’autistes Asperger, mais aussi des travaux plus récents dans le champ psychanalytique, notamment ceux de Jean-Claude Maleval [10], et ceux recueillis par Gwenola Druel [11]. Ces chercheurs et cliniciens ont eux pour objectif de faire entendre les voix singulières, les parcours de vies étonnants, et les inventions dont les sujets autistes sont les auteurs au quotidien.
La notion de golem pourrait effectivement viser les techniques cognitivo-comportementales, à savoir l’idée que le sujet autiste est façonné par la main de l’homme, produisant des êtres artificiels, mais elles ne concerneraient alors que les autistes soumis à ces pratiques. Cette idée est a contrario complètement étrangère aux cliniciens s’orientant de la psychanalyse. Pourquoi Lacan aurait-il mentionné « qu’il y a sûrement quelque chose à leur dire » [12], si l’autiste n’était qu’un pur objet inanimé attendant d’être construit par l’Autre ? Comment un psychanalyste qui possède une expérience de la clinique des autistes pourrait-il douter que ces sujets sont aptes à répondre à leur singulière manière ?

L’absence initiale de « limites », de « maîtrise », supposée par Charles Melman et qui devrait encore être démontrée, n’empêchent pas les autistes, pour peu qu’on n’y fasse pas obstacle, de construire des ilots de compétences qui les amènent à développer, parfois, une expertise inégalée et une identité remarquablement affirmée. Donna Williams, par exemple, se construit une identité morale et réflexive à l’appui de ses doubles, Willie et Carol.
L’indication sur leurs capacités de calculs « stériles » fait sans doute référence au cas de Daniel Tammet, autiste de type Asperger de 35 ans, qui a récité publiquement jusqu’à la 22 514 décimales de Pi, si bien qu’il s’est vu donner le sobriquet « d’homme ordinateur ». Mais c’est oublier son trajet, puisqu’il témoigne d’abord du fait que les nombres le « calment » et le « rassurent » [13], lui permettant de coder le langage. Il enseigne à ce jour les langues…
Faut-il encore évoquer le cas de Jacob Barnett [14], qui a reçu étant encore enfant le diagnostic d’autisme grave, et qui a 15 ans seulement aujourd’hui est l’un des chercheurs en physique les plus prometteurs de sa génération ? Ou encore le cas de Fritz V., suivi par le pédiatre autrichien H. F. Asperger, devenu professeur d’astronomie et qui corrigea une erreur dans les travaux de Newton qu’il avait repérée dans son enfance.
Les capacités de calcul de ces sujets « autistes » n’ont rien de stériles et ils n’ont rien à voir avec des Golems. Ces capacités participent souvent au développement de compétences sociales par l’entremise de leurs inventions, comme l’a fait Temple Grandin [15] avec sa fameuse « trappe à bétail », pour devenir docteur en sciences animales et spécialiste de renommée internationale en zootechnie. Comme le note Eric Laurent, « l’invention est le seul « remède » du sujet autiste » [16].
Les trajectoires toujours uniques de ces enfants sont souvent marquées de rencontres décisives avec des personnes qui font le choix de les accompagner en les écoutants, en suivant leurs idées et leurs goûts particuliers. Psychanalystes, parents, frères, sœurs ou éducateurs, ne peuvent souscrire aux propos de Melman qui semblent manquer pour le coup d’une instance morale et réflexive. Toutes leurs expériences lui crient l’opposé des mots qu’il emploie.
Il est étonnant que Charles Melman – en sa qualité de psychanalyste - soit frappé d’amnésie quant aux enseignements de celui qu’il prétend suivre : l’éthique psychanalytique suppose à tout être humain l’espace d’une subjectivité.
L’autiste n’est donc ni golem, ni vide, mais un créateur !
Charles Cullard
Source : Mediapart.fr
[3] Jean-Claude Maleval, « Note sur la HAS, l’autisme et la psychanalyse », Lacan Quotidien n°242
[4] Le collectif de praticiens auprès d’autistes est issu d’un cartel formé en 2004, composé alors de Martine Guillot enseignante, Michel Forget chef de service en IME, Sessad et foyer d’hébergement, Myriam Perrin psychologue sur un dispositif d’enfants et adolescents autistes en IME, et le plus-un : Jean-Claude Maleval, Professeur à l’Université, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne.
[5] En 1998, un groupe de professionnels praticiens de l’autisme a fondé l’Association PREAUT afin de réaliser une recherche visant la validation d’indicateurs de troubles de la communication chez le bébé au cours des deux premières années de la vie pouvant présager un trouble envahissant du développement du spectre autistique. http://preaut.fr/
[6] Anne Idoux-Thivet, Ecouter l’autisme, le livre d’une mère d’enfant autiste, Autrement, 2009
[7] Jacques Lacan, « Propos sur la causalité psychique », in Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 177
[8] Pierre-Gilles Guéguen, Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle », 5 minutes à la radio, réalisé par Anaëlle Lebovits-Quenehen
[9] Rosine et Robert Lefort, La distinction de l’autisme, Seuil, Avril 2003
[10] Jean-Claude Maleval, L’autiste et sa voix, Coll. Champ Freudien, Seuil, Octobre 2009
[11] Gwenola Druel, L’autiste créateur. Inventions singulières et lien social, PUR, 2013
[12] Jacques Lacan, « Conférence à Genève sur le symptôme » (1975), in Bloc-notes de la psychanalyse n° 5, 1985
[13] Daniel Tammet, « Le surdoué des langues qui voit et parle en chiffres », Le Monde, 5 août 2007
[14] Kristine Barnett, L’étincelle : La victoire d’une mère contre l’autisme, Fleuve Noir, Octobre 2013
[15] Temple Grandin, Ma vie d’autiste, Odile Jacob, Janvier 2001
[16] E. Laurent, La bataille de l’autisme. De la clinique à la politique, Navarrin, Paris, 2012, p. 65.
 Écouter les autistes
Écouter les autistes