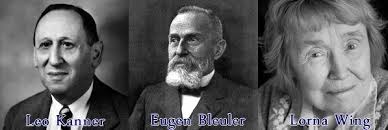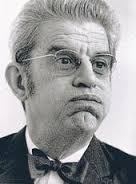Accueil > Actualités > « Autisme et vivre ensemble »
 « Autisme et vivre ensemble »
« Autisme et vivre ensemble »
mercredi 25 décembre 2013, par
Dans le cadre de la semaine d’information de la santé mentale, le 18 mars 2010, les Champs Libres, centre culturel rennais, organisait, en partenariat avec l’acf-vlb, une conférence-débat sous le titre « Autisme et vivre ensemble ». Astrid Massiot, responsable de la programmation des Champs Libres, a pris comme point d’appui le livre collectif de praticiens auprès d’autistes – « L’autiste, son double et ses objets » sous la direction de Jean-Claude Maleval [1] –, dans un souci d’échange entre ces cliniciens, qui considèrent que l’autiste n’est pas un handicapé mental mais un sujet au travail pour tempérer son angoisse, et un public très éclectique, intéressé par le traitement de l’autisme aujourd’hui.
Près de quatre cent cinquante personnes ont assisté à cette conférence-débat. Jean-Claude Maleval, psychanalyste, membre de l’ECF, et professeur en psychopathologie, Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste, membre de l’ECF, et directeur du Centre thérapeutique et de recherche Nonette, et Yves Lapie, militant associatif et Président de la Commission Départementale des Droits et d’Autonomie des Personnes en situation de Handicap étaient réunis pour une conversation animée par Y. Lapie.
Les liens tissés par l’Acf-vlb avec A.Massiot, organisatrice des conférence-débats, nous ont permis d’envisager cette soirée, dans ce lieu alpha, orientés par un souci de transmission, guidés par la nécessité de faire connaître du grand public ce qui fait le particulier de notre orientation face l’omniprésence médiatique des thérapies cognitivo-comportementales quant à l’autisme. Au sein de la semaine d’information de la santé mentale, un coup politique (local) était à jouer, la couverture médiatique de l’événement nous sera d’ailleurs très favorable.
Yves Lapie connaît bien la clinique auprès des autistes : il fut directeur d’institutions médico-sociales où il soutenait la ‘‘psychanalyse appliquée’’ pour accueillir les sujets psychotiques et autistes (Ie La Passagère – Saint-Malo) et fit intervenir des analystes de l’ECF et du RI3. C’est du côté du signifiant « parent » que Y.Lapie se place dans ce débat – bon nombre de représentants d’associations parentales, régies sous l’égide cognitive sont présents dans la salle. Il introduit dans la discussion le document de l’Agence Nationale d’Evaluation et de la Qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux paru en 2009 sur « Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles » pour les personnes avec autisme et ou présentant des THED. Il y relève plusieurs signifiants : « dignité », « intégrité morale et physique des personnes concernées », « projet personnalisé et spécifique », « démarche de bientraitance », avant de demander à Jean-Claude Maleval « Comment vivre ensemble avec les autistes ? »
Si J-C.Maleval rappelle d’abord les différentes orientations de traitements de l’autisme – psycho-dynamiques, méthodes comportementales et cognitivo-comportementales – et insiste sur les plus connues – aba, teach, etc.–, s’il fait état de l’avancée de ses recherches [2] - situant l’autisme comme « quatrième structure », notamment par son mode original de fonctionnement localisant la jouissance sur un bord, par le traitement du langage qui se fait en le tenant à distance de cet objet angoissant que constitue la voix, et par son évolution non vers la schizophrénie mais vers un autisme mieux compensé -, c’est surtout en proposant d’écouter les autistes eux-mêmes qu’il répond à la salle. « Tous les autistes ne sont pas muets ». J-C.Maleval déplace la position de savoir, il se décale d’un débat stérile et guerrier du champ contre champ. En donnant la parole au sujet autiste, il fait donc entendre ce qu’ils (les autistes) en pensent : Tous s’élèvent contre les méthodes éducatives coercitives : « Elles ne prennent pas en compte la spécificité de notre fonctionnement ». Quant à leurs dires à propos du recours des méthodes éducatives à l’opposition récompense/punition : « le principe de la discipline, dit Donna Williams, fait la grossière erreur de supposer que le coupable se demande pourquoi […]. Les punitions ne signifiaient rien. Elles n’avaient aucun lien logique avec les actions qu’elles étaient censées réprimander. J’ignorais totalement ce que j’avais fait. Au mieux, j’essayais de comprendre à quoi ressemblait une ‘‘fille gentille’’ et de l’imiter » [3]. « Je ne vois pas comment une telle méthode aurait pu marcher, dit Sean Baron. Je me fichais bien des récompenses et des punitions. Je n’avais envie de rien […] alors de quoi auriez-vous pu me priver ? » [4]
Un premier acte est posé. Les autistes ont quelque chose à dire !
Puis, J.-C. Maleval donne la parole aux parents d’autistes et oppose deux témoignages aux approches radicalement opposées. Qu’en conclure ? Des effets thérapeutiques étant perceptibles dès que l’Autre intervient, il en va de la responsabilité, de l’éthique de chacun de savoir s’il veut les obtenir par la violence et la coercition ou par la douceur et le jeu. Un silence envahit la salle, manifestation de l’effet de surprise ! « Il est bien plus agréable, pour tout le monde, constate Hilde de Clercq, une autre mère d’autiste, de suivre la façon de penser de ces enfants […] que de leur imposer de s’adapter et d’être confrontés constamment à des problèmes de comportement. La meilleure stratégie pour éviter des problèmes de comportement est de les anticiper. » [5] « Et pour les anticiper, ajoute J.-C. Maleval, il faut comprendre leurs fonctions. »
Quant aux Recommandations des bonnes pratiques fondées sur une approche de masse armée de statistiques, J.-C. Maleval rappelle que les psychanalystes « préfèrent aux bonnes pratiques les meilleures pratiques » c’est-à-dire celles qui prennent en compte la singularité du sujet. Ce rapport tend justement à s’ouvrir à ces ‘‘meilleures pratiques’’ et borne les techniques d’apprentissages quand celles-ci sont si contraignantes qu’elles s’approchent de la maltraitance. La recommandation essentielle de ce document réside, pour J.-C. Maleval, dans le fait de « chercher à recueillir le consentement libre et éclairé de la personne », ainsi que la prise en compte de la déclaration des droits européens des personnes autistes de mai 1996 : « Reconnaître et respecter les désirs des individus de sorte que les autistes devraient avoir le droit de ne pas être exposé à l’angoisse, aux menaces et aux traitements abusifs ». « Il reste beaucoup de travail à faire, conclut J.-C. Maleval, pour que de telles recommandations parviennent jusqu’aux institutions qui orientent leur travail sur le principe de « ne jamais leur céder ».
Jean-Pierre Rouillon témoigne alors que c’est à partir de la difficulté de la relation à l’Autre des sujets autistes que se sont construits les modes de réponses à Nonette, avec pour principe : un accueil au un par un. Pourquoi ? Parce que Nonette s’est appuyée sur ce que ces sujets lui ont enseigné : « Premièrement, ces sujets, précise J.-P. Rouillon, n’étaient pas sans lien à l’Autre mais très présents, très attentifs à ce que l’on faisait, mais l’on se présentait avant tout comme des menaces pour eux, ils se méfiaient de nous ». Discrétion, douceur, subtilité, pour ne pas imposer une présence, viendront faire orientation dans l’accueil de ces sujets. Deuxième constat, avec son lot de surprises : une relation à l’autre est possible : « un attachement extrêmement important pour des personnes qu’ils avaient choisies à l’intérieur des équipes », attachement porteur d’un lien. Ne pas se refuser à ce contact, aussi massif soit-il, est un autre signe d’accueil adressé au sujet, bien que puisse y cohabiter la plus grande tendresse avec la plus grande violence. Ainsi à Nonette, ce qui oriente le partenaire du sujet autiste, c’est l’attention portée à repérer comment chacun construit l’espace dans lequel il se déplace avec ses points de ruptures, de discontinuité (détresse qui provoque des crises) car « au fond, poursuit J.-P. Rouillon, pas un d’entre eux n’a la même institution ! »
J.-P. Rouillon témoigne également de l’accueil fait aux parents, et la manière dont il s’emploie à leur faire entendre que tout n’est pas fini, que leur enfant à des capacités créatrices, et que « tout peut commencer ! » Nouvel effet de surprise dans la salle !
L’acte de paroles de nos deux collègues intervenants fut de rendre à ces sujets la dignité de leur façon d’être au monde, et comment, alors, un « vivre ensemble » est possible.
Il n’y a pas eu de débat houleux, ni de critique acerbe, mais un vent de respect et d’humanité. Une jeune femme a remercié les intervenants de parler de vies humaines dignes d’être vécues, et non d’êtres réduits à leur handicap, et rajouterais-je, à des objets de soins, à des objets à rééduquer. Qu’une telle soirée puisse se tenir, n’était-ce le vœu de Freud que la psychanalyse joue sa partie dans la société, car celle-ci a à y trouver des bénéfices ? Le pari de la rencontre a été tenu : pas de querelles mais des effets de surprises, pour que cette soirée traduise un lien social possible qui rassemblent professionnels et parents, étudiants et famille, université et lieu de soin, soit un « vivre ensemble possible » dans l’échange et le respect de chacun. Quel retour ? Pas d’institutionnel sans politique : le psychanalyste et son désir au cœur de la cité produit des effets.
Myriam PERRIN
Mars 2010
La conférence de cette soirée est disponible à l’écoute sur www.radio-a.com.
http://www.radio-a.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=119
[1] Maleval J-C. (Sous la dir. De). L’autiste, son double et ses objets, Ouvrage collectif, PUR, Rennes, 2009.
[2] Maleval J-C. L’autiste et sa voix, Champ Freudien, Seuil, Paris, 2009.
[3] Williams Donna. Si on me touche, je n’existe plus, Robert Laffont, collection J’ai lu, Paris, 1992. Quelqu’un, quelque part, 1994, J’ai lu, 1996.
[4] Baron Juddy et Sean. Moi, l’enfant autiste, 1992, Editions J’ai lu, Paris, 1993.
[5] De Clercq Hilde. Dis maman, c’est un homme ou un animal ? » Autisme Diffusion AFD, 2005.
 Écouter les autistes
Écouter les autistes