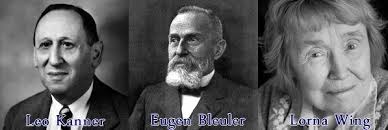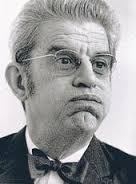Accueil > Actualités > Projection-débat du film documentaire « Sa normalité » d’Eugénie Bourdeau
 Projection-débat du film documentaire « Sa normalité » d’Eugénie Bourdeau
Projection-débat du film documentaire « Sa normalité » d’Eugénie Bourdeau
vendredi 4 avril 2014, par
La projection du film s’est inscrite dans le cadre du Festival Zanzan, cinéma et art des différences, à l’occasion de leur 3e édition. Cette diffusion a été suivie d’un débat en présence d’Eugénie Bourdeau, réalisatrice du film. Née en 2002, Lucile fut tout de suite une enfant différente : autiste… une faute de frappe sans doute.
Sa singularité a été livrée par sa mère Eugénie Bourdeau dans un film émouvant.
La projection a été suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et d’un débat sur le thème de la création artistique des autistes avec Gwenola Druel, maître de conférences en psychopathologie clinique ; Mariana Alba de Luna, chargée culturelle de l’association « La main à l’oreille » et Jean-Claude Maleval, professeur de psychologie clinique et pathologique.
Des dessins originaux de Lulu ont été exposés à l’entrée de la salle de conférences.
Suite à la diffusion du film, Lucile qui était présente a rejoint les intervenants sur scène et nous a offert un petit concert, reprises très personnelles de quelques morceaux. De la même façon, nous l’avons découverte dans le film chantant avec les « pas musiciens », Lucile était là, parmi nous, à sa manière propre et si singulière.

Projection-débat du film documentaire « Sa normalité » d’Eugénie Bourdeau le 4 avril 2014 aux Champs libres à Rennes
Sa mère, la réalisatrice, a pris la parole pour préciser que les raisons de ce film s’incarnaient dans ce moment : montrer la liberté de sa fille, et « dénoncer » les limites de notre normalité.
Jean-Claude Maleval intervient alors pour expliquer que « la méthode » de cette mère va à l’encontre des recommandations de l’HAS ! Elle soutient les dessins de sa fille, ayant idée qu’ils ont une fonction, là où certains y voit une auto-stimulation non bénéfique. Soutenir les intérêts, cultiver les passions, en passer par un apprentissage de biais, telles sont les pistes proposées pour accompagner ces sujets... Il faudrait pouvoir collaborer et discuter avec les tenants des diverses approches, mais il semble que cela reste très difficile d’échanger...
Concernant Lucile, J.C. Maleval interroge : « comment aller plus loin que les dessins ? Comment s’introduire dans son travail ? Il existe peut être des risques « d’auto-stimulation », soit d’une trop grande fascination qui conduirait le sujet à ne pas vouloir céder sur cette satisfaction. L’idée serait d’utiliser les dessins pour aller du coté des apprentissages, avec en ligne de mire l’écriture.
Eugénie Bourdeau explique alors que Lucile y vient doucement, à son rythme, et qu’elle a arrêté de comparer, qu’elle accepte que sa fille ait sa temporalité, sa façon de faire. Lucile peut être brillante dans des domaines où on ne l’attend pas du tout, alors qu’on pourrait se dire que ce n’est pas un domaine important et qu’il vaudrait mieux qu’elle apprenne à lire et à écrire. Puis Eugénie Bourdeau explique qu’elle a cédé là dessus, se disant que ces biais détournés l’amèneraient peut être à l’écriture...
Puis Eugénie Bourdeau répond à J.C. Maleval pour préciser qu’elle ne considère pas utiliser une méthode, qu’elle a juste suivi sa fille. Elle soutient sans influencer... et à Mme Carlotti, elle répond que sa priorité, c’est le bien être. Soutenir ce qu’est l’enfant plutôt que de l’obliger à être ce que nous nous voudrions qu’il soit. Indiquer à l’enfant que ce qu’il est, c’est bien, et qu’on l’aime comme cela. Elle pointe le fait que l’on félicite l’enfant autiste uniquement s’il répond à nos attentes, à nos demandes. Leur renvoyer une image très positive de ce qu’ils sont dans leur différence est très important.
Gwénola Druel intervient alors pour répondre à Eugénie Bourdeau, qui dit qu’effectivement elle n’applique pas une méthode, mais qu’elle nous enseigne sur le fait qu’elle suive sa fille sans la précéder. Est évoqué le blog de Lucile où l’on retrouve deux ouvrages avec les dessins de Lucile, commenté par sa mère. « Elle commencera par des points, des points partout, puis vient des esquisses de rond, des ronds fermés, et enfin des points dans des ronds... oh ! Un bonhomme ! »
En ne répondant pas à ses questions, la mère laisse un espace à sa fille pour qu’elle y loge ses propres créations. Et ça peut commencer par des petits points ! Faut accueillir chaque petit bricolage, chaque petit point, chaque petit trait, pour que le sujet en fasse quelque chose.

E. Bourdeau ajoute qu’elle a totalement confiance en sa fille à ce niveau, mais que c’est l’extérieur qui lui fait douter d’elle. A la maison, la plus handicapée des deux, c’est la mère, car Lucile sait où elle en est, elle sait s’écouter, elle ne sait pas le communiquer dans un langage que nous nous comprenons, mais elle exprime des choses... « On les condamne en les excluant et on leur fait subir notre incapacité à les comprendre. Ils sont punis du fait d’avoir une autre intelligence que la notre. »
Marianna Alba de Luna présente alors l’association La Main à l’Oreille, dont est membre Eugénie Bourdeau.
M. Alba de Luna souhaite retourner cette phrase « dans le respect des recommandations... » non pas de ce que l’Autre veut, ou de ce que l’Autre a décidé d’une façon politique et législative, mais dans le respect du sujet, dans le respect des recommandations que le sujet nous fait avec chaque petit détail qu’il laisse à voir. La présence de Lucile nous donne quelque chose avec sa présence sur scène qui décale de la simple image générée par le film, par ses nombreux dessins. Elle peut sortir de l’image et être là, et cela nous invite à l’accueillir elle aussi, et pas ce qu’on était en train de s’inventer en regardant le film. Séquence du film où Lucile chante en silence, à contre temps, seule dans la cour la musique du spectacle de fin d année, elle rejoue la scène...
J.C. Maleval reprend le fait qu’effectivement, E.Bourdeau ne suit pas une méthode mais suit son enfant. Aujourd’hui, ce qu’on nous dit, c’est qu’il faut suivre une méthode. Alors il y a deux manières de prendre les choses, soit on considère que le savoir est du coté des éducateurs etc, soit on considère qu’il est du coté des enfants autistes qui sont tous différents, et qu’à chaque fois il faut les écouter pour découvrir ce savoir. Il faut aussi un « doux forçage » pour aller un peu plus loin. Donc soit on choisit de partir du savoir sur l’autisme, mais qui est incroyablement flou, car on n’est incapable de définir ce qu’est l’autisme, il n’y a aucun marqueur biologique de l’autisme, on sait à peu près où ça commence mais on ne sait absolument pas où ça finit. Sur les formes de l’autisme de haut niveau, les autistes ne sont absolument pas d’accord... on nous dit qu’il faut passer des tests, mais les tests sont déjà calibrés au départ par rapport à une certaine conception de l’autisme, ils ne sont pas tous d’accord sur ce qu’est l’autisme, donc il y a un flou, le DSM V ne sait plus si les autistes Asperger doivent rangés dans l’autisme etc... on est passé en quelques années de un cas sur 10000 aux USA à un cas sur 88. donc on ne sait pas trop ce qu’est l’autisme et on ne sait pas trop comment le traiter. Le plus sage à faire est donc déjà de s’orienter de ce qu’ils ont à nous apprendre et de voir quelles sont les solutions très différentes qu’ils inventent les uns les autres mais qui ont quand même quelques points communs. Le savoir des « spécialistes » a un intérêt mais ils veulent imposer des méthodes comme étant les seules possibles alors que cela devrait être des méthodes parmi d’autres...
Autonomie VS indépendance...
Suite à une question émanant du public, J.C. Maleval explique que le but de toutes les méthodes est de rendre indépendants les enfants autistes, mais les méthodes comportementales, dans le meilleur des cas ne les rendent qu’autonomes, c’est à dire qu’ils vont manger seuls, être propres, ils sauront se débrouiller, mais ça ne les rendra pas indépendants. Pour qu’ils soient indépendants, il faut qu’ils puissent prendre appui sur leur vie émotionnelle, et ça, ça s’enseigne pas ! Pour cela, il faut aller dans leur sens. Il faut partir de leur passion pour qu’ils puissent plus tard mobiliser leur vie émotionnelle pour prendre des décisions. L’indépendance, c’est cela : être capable de prendre des décisions seul. Alors que les méthodes d’apprentissage les rendent autonomes mais pas indépendants, pas capables de prendre des décisions sans s’en référer à d’autres, sans suivre l’avis des autres. C’est un des avantages des méthodes psychodynamiques, même si ces méthodes psychodynamiques ne sont pas adaptables à tous les autistes... Effectivement, elles marchent mieux avec les autistes qui ont un intérêt spécifique, comme la passion pour le dessin etc. Il est vrai que tous les autistes n’ont pas un intérêt spécifique, certains sont extrêmement déficitaires, ils n’ont pas d’objet, alors là, peut être que les méthodes comportementales peuvent permettre une certaine amélioration de leur comportement, mais ils n’en feront pas des gens capables de s’appuyer sur leur vie émotive pour s’autonomiser...

Cécile Wojnarowski pose une question concernant la scène avec l’homme dans le film, où on ne sait plus qui précède qui, qui suit qui, et où l’on peut constater que quelque chose s’échange... C’est une position difficile de se régler sur le savoir de l’autiste, sur le savoir de l’autre en général, car on a toujours envie d’en savoir un petit bout de plus, d’être un peu en avance... et alors, qui est cet homme ?
E. Bourdeau explique que c’est un metteur en scène qui travaille avec Lucile et qui a écrit sa pièce... un peu avec elle en fait ! Il avait une histoire, il lui la racontait, cela passionnait Lucile, notamment les personnages féminins, et donc elle dessinait (ou pas, rien d’imposé) pendant qu’il racontait, elle posait des questions qui alimentaient l’histoire, et après ses dessins seront mis en scénographie pendant la pièce... cela montre que lorsque l’on va sur son terrain, la communication est beaucoup plus facile ! Ici elle a une écoute et elle va même plus vite que lui, car il n’a même pas le temps de répondre à ses questions.
Gwénola Druel pointe qu’il la suit de façon délicate mais qu’il amène quand même quelques petits éléments supplémentaires. Par exemple quand il parle de cette poupée espagnole, c’est lui qui nomme que c’est une poupée, qu’il y a des points sur la robe... c’est le petit pas supplémentaire en amenant quelque chose d’autre dans les échanges et Lucile reprend... quelque chose se tisse entre eux deux, dans un échange de parole.
Marianna Alba de Luna reprend sur le « petit point » qui fait lien social en venant se loger dans la robe qui fera le spectacle... ce qui n’était au début qu’un point peut se développer, évoluer...
Exemple d’une soignante qui se plaignait que Lucile lui demande chaque matin ce qu’elle avait mangé la veille. Elle ne voulait pas répondre, l’important n’étant pas là pour elle, mais qu’il faut apprendre les lettres etc. Et donc cette soignante ne répondait pas aux questions de Lucile, mais ne comprenait pas qu’en retour Lucile ne réponde pas à ses propres questions ! Elle aurait pu partir de cette réponse, j’ai mangé des petits pois, pour parler des couleurs, des formes, du temps de cuisson qui permet un lien aux chiffres etc...
E. Bourdeau pointe le fait de prendre ou non le temps de répondre à ce genre de questions, car il faut se poser deux minutes, réfléchir à ce qu’on a mangé la veille... elle dit alors son incompréhension des personnes souhaitant travailler auprès d’autistes en ayant déjà à la base un planning bouclé et chronométré de ce qu’on veut faire. Pour elle, c’est aller droit dans le mur car ce n’est pas possible. Pour être avec Lucile, il faut être disponible, et respectueuse de sa manière de faire échange.
Pratiques diagnostiques et prises en charge
Suite à une question du public, J.C. Maleval explique ne pas forcément être compétent pour répondre... ce qui est prôné est de faire des dépistages le plus tôt possible, avec des tests variables et discutables car il n’y a pas de consensus international sur ce qu’est l’autisme. La prise en charge est quant à elle extrêmement différente selon les institutions. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a un manque considérable de places en France et que les méthodes vont être très diverses d’un établissement à l’autre. La discussion se poursuit sur les enjeux des diagnostics, avec les avantages et les inconvénients.
Marianna Alba de Luna évoque trois témoignages :
Une fillette exclue de son école parce qu’elle venait d’être diagnostiquée autiste, alors que tout se passait très bien jusque là, mais la directrice a pris peur...
Une autre famille qui explique qu’elle est en attente d’un diagnostic que personne ne veut ou ne peut lui donner, et qui pense que leur fils est autiste via les forums des associations, mais personne ne vient nommer cela, et qu’ils sont de ce fait perdus. Sont alors évoqués le moment de l’annonce et l’importance de l’accompagnement de la famille et de l’enfant.
Autre exemple d’un jeune homme qui a été déclaré inapte au travail car diagnostiqué autiste, alors qu’il avait les diplômes universitaires et les compétences requises pour son poste : deux ans de bataille judiciaire pour le faire reconnaître « apte ».

Marianna Alba de Luna évoque l’histoire de sa sœur autiste, l’égarement d’une temporalité qui s’arrête, où plus personne ne peut être à sa place, où il n’y a pas de nomination, où l’enfant est différent et trouble un peu. M. Alba de Luna avait besoin qu’on nomme qui était cette sœur étrange et sa mère a trouvé une image d’une rose bleue, une petite fille appelée la rose bleue, et lui a dit que sa sœur était comme cela, une rose bleue : elle est différente, fragile et singulière comme une rose bleue... cela faisait office de diagnostic ! Diagnostic qui s’inscrivait dans la vie, donnait une place à chacun, plutôt qu’un diagnostic d’autisme qui ne lui aurait pas parlé.
Gwénola Druel reprend l’autiste comme artiste, là où on retrouve souvent des représentations du coté du déficit, de ne pas pouvoir apprendre, de ne pas pouvoir parler etc.
E. Bourdeau introduit cette faute de frappe pour indiquer qu’elle est du coté de l’artiste. Effets du diagnostic qui vient nommer, étiqueter le sujet sous ce terme, là où E. Bourdeau décale les choses en la nommant artiste, et ça produit des effets.
E. Bourdeau explique que Lucile l’a fait se questionner sur notre normalité à nous... elle ne considère pas que nous ayons raison sur tout dans notre normalité. Tous les jours, Lucile la fait se remettre en question sur les limites qu’elle s’impose ou qu’on lui impose, et sur cette personne qu’elle est devenue de n’avoir pas eu le choix que de rentrer dans ces codes de normalité. Puis elle revient sur la question de l’autonomie. Elle pense que Lucile pourra s’autonomiser, à son rythme, à sa manière à elle, mais elle interroge : cette autonomie, elle est pour qui ? Pour nous ? Pour nous libérer ? Ou pour eux même.
E. Bourdeau se pose souvent la question de savoir où Lucile sera la plus heureuse, comment ?
J.C. Maleval indique qu’on ne se questionne pas assez sur cette question du diagnostic d’autisme : beaucoup veulent diagnostiquer tôt, et cela peut être positif, mais cela peut aussi être une catastrophe d’avoir cette étiquette sur eux, ça les rend différents à jamais. Ça a des avantages pour faciliter l’intégration scolaire via des A.V.S., c ar les autistes ont besoin de s’appuyer sur quelqu’un, l’intégration est souvent difficile. Malheureusement, la formation des A.V.S. est une catastrophe, où on dit qu’il faut seulement que les autistes apprennent à obéir. Il n’y a pas de formation à la psychologie de l’autisme... D’ailleurs la méthode A.B.A. ne se cache pas de ne pas s’intéresser à la psychologie de l’autisme puisque le créateur de cette méthode dit que l’autisme n’existe pas, qu’il n’y a que des anormaux. La méthode Teacch est plus fine concernant la psychologie de l’autisme, mais elle n’est pas recommandée non plus... donc le diagnostic, ce n’est pas si simple que ça, ça peut poser problème, il faut y réfléchir au cas par cas, chaque autiste est différent, et chaque famille d’autiste est différente...
Marianna Alba de Luna parle au nom de La Main à l’Oreille qui privilégie l’accueil au diagnostic...
Puis vient le témoignage d’une infirmière en pédo-psychiatrie, Geneviève Touquette, qui a écrit un livre : « Chronique hospitalière d’un autisme ordinaire ». De la salle, elle explique comment elle travaillait en 1975-1980, avant toutes ces méthodes, avec l’importance de la rencontre, au delà du diagnostic, de l’anamnèse. Elle prend l’exemple d’une petite fille très isolée, accueillie pendant cinq ans, qui a désormais quarante ans, qui travaille, et qui vient d’acheter son appartement, soutenue par ses parents...
L’animatrice des Champs Libres considère que les réponses aux questions d’E. Bourdeau se retrouvent dans les dessins de Lucile, et que c’est très touchant.
E. Bourdeau redit qu’elle n’interprète pas les dessins de sa fille mais que c’est un moyen d’expression et une façon de comprendre que cette enfant est bien là. Un enfant qui ne vous regarde pas quand vous lui parlez ne veut pas dire qu’il ne vous écoute pas... Lucile arrive à écouter une histoire en parlant... Le dessin est un mode d’expression, mais il y en a plein d’autres, que l’on ne perçoit pas forcément, que l’on ne comprend pas, ce qui peut expliquer que l’enfant finisse en crise, à ne pas être entendu, à ne pas être compris, à ne pas être reconnu...
L’animatrice reprend la place de la création quand on n’arrive pas à se faire entendre.
Gwénola Druel pointe c’est un choix de ne pas interpréter les dessins de Lucile, mais qu’on peut quand même noter que quelque chose se met en scène du coté du mouvement, du mouvement du corps, d’ailleurs on la voit dans le film devant le miroir, ou avec son ombre : elle court...
On voit souvent dans ses dessins deux bonhommes qui s’entrelacent. Lucile réfléchit à comment elle va nommer son mari. C’est toute la question de la rencontre entre un garçon et une fille, avec le baiser qui revient souvent, et les émotions, la tristesse, la colère... on voit comment dans les dessins, il y a quelque chose du corps, de la rencontre avec l’autre, des émotions qui peuvent envahir, et l’on retrouve tout cela dans les dessins. Met elle au travail ce qui est difficile pour elle dans la rencontre ? On voit qu’elle ne fuit pas les autres, qu’elle serait plutôt à chercher à les rencontrer, mais comment ?
E. Bourdeau explique qu’effectivement, Lucile rentre dans l’adolescence, elle s’intéresse aux garçons...
Marianna Alba de Luna relève que les dessins au bic noir de Lucile ont pris de la couleur du jour au lendemain, sans doute en lien avec un changement pour elle. Ça commence par un rouge aux lèvres.
E. Bourdeau pense que c’est arrivé quand elle a eu ses changements de femme dans son corps, la couleur peut enfin s’inscrire dans le corps... (à ce propos, c.f. D. Tammet sur l’importance de la couleur dans sa structuration du monde.)
Il faut aussi parler de ce qui est dur pour les familles. On ne voit pas ce coté là dans le film, c’est un parti pris, de montrer autre chose, de ne pas alimenter la fascination provoquée par ce qu’on voit...
E. Bourdeau ne voulait pas montrer une image trop violente de l’autisme, même si elle reconnaît que ce n’est pas toujours facile car Lucile est dans l’opposition pour tout. Il faut que la demande soit cohérente pour elle. Elle n’écrit que pour la liste des courses car manger est important pour elle !
Marianna Alba de Luna rappelle les propos d’un autiste qui s’étonnait que les gens parlent pour ne rien dire !
Lucile arrive avec ses affaires et dit qu’il est temps de rentrer !
 Écouter les autistes
Écouter les autistes