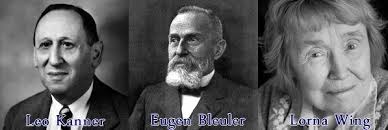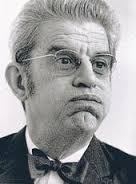Accueil > Publications > Extension du spectre de l’autisme
 Extension du spectre de l’autisme
Extension du spectre de l’autisme
lundi 27 octobre 2014, par
Résumé : Le noyau dur du spectre de l’autisme réside dans les passages du syndrome de Kanner au syndrome d’Asperger ; mais il s’étend encore largement en-deçà du premier et au-delà du second. Son unité clinique ne se dégage qu’en prenant en compte la défense autistique majeure qui se caractérise par la construction d’un bord. Celui-ci se fonde en une carapace délimitée à partir de la surface corporelle qui commande une rétention des objets pulsionnels. Le bord se complexifie par l’entremise de l’objet autistique, du double et de l’intérêt spécifique. Son évolution atténue sa fonction anesthésiante de protection contre les émotions et contre les intrusions de l’Autre. Chez les autistes de haut niveau le bord s’efface tandis que s’accentue son ouverture. Subsiste cependant dans leur fonctionnement une scission entre un espace subjectif intime, secret, dont la jouissance doit restée inentamée, et un espace subjectif social, qui s’appuie sur un Autre de synthèse, dont la majorité des éléments sont appris par cœur. L’autiste enfermé dans un bord forgé sur la surface corporelle s’avère difficile à différencier du schizophrène ; en revanche l’autiste dont le bord est effacé peut devenir socialement invisible et n’être jamais diagnostiqué comme tel.
L’observation de passages du syndrome de Kanner au syndrome d’Asperger a donné naissance dans les années 1980 à la notion du spectre de l’autisme [1]. Le devenir de Donald Gay Tripplet, le cas n° 1 de l’article princeps de Kanner, en est le plus démonstratif et le moins contestable. Observé dans les années 1930 au Johns Hopkins Hospital de Baltimore, il profitait en 2010 d’une paisible retraite dans le Mississipi. Après avoir travaillé comme caissier dans la banque de ses parents, il vivait indépendant et seul, conduisait toujours sa voiture, et continuait à cultiver ses loisirs : le golf et les voyages [2]. De telles évolutions constituent le noyau dur du spectre [3]. Cependant les limites de ce dernier s’avèrent difficiles à préciser. Du côté des formes les plus sévères, en deçà de la clinique de Kanner, se situe un pôle incertain, tant le diagnostic différentiel avec la schizophrénie infantile peut s’avérer difficile. À l’opposé, au-delà de la clinique d’Asperger, se situe un pôle invisible constitué d’autistes devenus indépendants, pour lesquels le diagnostic est parfois posé très tardivement, voire jamais.
La plupart des chercheurs contemporains postulent l’existence d’un spectre autistique, dont la notion apparaît en 2013 dans le DSM-5, mais ils s’avèrent à la peine de l’objectiver à partir d’une approche fondée sur l’étude des comportements, tant la diversité de ceux-ci est étendue, de sorte que chacun constate le caractère flou et changeant du diagnostic, dont témoigne sa considérable extension au début du XXIe siècle, faisant évoquer une épidémie. Deux voies sont possibles pour le rendre plus précis : un approfondissement de sa clinique, ou une découverte de sa causalité. L’approche scientifique dominante parie exclusivement sur la seconde hypothèse : elle attend la découverte d’un marqueur biologique. Certains ont même l’audace de le prédire pour bientôt. Pourtant les efforts et les moyens considérables déployés depuis plusieurs années ont abouti à des résultats assez décevants. Depuis l’énorme travail de l’Autism Genome Project effectué en collaboration par plusieurs Universités et portant sur 1400 familles l’hypothèse de l’existence d’un gène unique est aujourd’hui abandonnée. Les quelques mutations génétiques objectivées dans un petit nombre de cas s’avèrent d’une grande diversité. Elles incitent à chercher maintenant du côté de multimutations génétiques spontanées dont les interactions avec l’environnement sont probables et méconnues. Autant dire que le problème s’est sérieusement complexifié dans la première décennie du XXIe siècle. Dans ce contexte, beaucoup de chercheurs scientifiques commencent à considérer le diagnostic d’autisme comme un obstacle épistémologique ; de sorte qu’ils envisagent une nouvelle méthodologie fondée non plus sur une quête de l’étiologie de l’autisme, mais plus modestement sur la causalité de certains traits de comportements appartenant au syndrome [4]. Plus la recherche concernant la biologie de l’autisme s’approfondit, plus la solution semble s’éloigner. L’autre voie pour comprendre ce qu’est l’autisme et pour affiner ses traitements consiste à chercher à mettre en évidence une logique qui fonctionne au-delà des comportements. Quel que soit le corps dont le sujet dispose il doit composer avec celui-ci. C’est au fonctionnement subjectif que la recherche clinique se consacre, et il ne saurait se réduire à la biologie, car le sujet se construit en permanence dans une corrélation à des objets. L’impact que ceux-ci peuvent avoir sur sa construction n’est pas préalablement inscrit dans son corps. Le sujet se développe dans une dimension historique que les gènes ne connaissent pas - même s’ils peuvent en baliser l’extension. Les outils et les méthodes de la recherche clinique sont indépendants de ceux de la biologie. Tenter de déterminer la spécificité du spectre de l’autisme par cette voie n’est pas moins légitime que de parier sur le biologique.
Le bord comme surface corporelle
Les autistes auxquels les psychanalystes ont consacré leurs principaux travaux de Meltzer aux Lefort, en passant par Tustin et Bettelheim, sont en grande majorité des autistes pré-kannériens. Des autistes qui n’ont pas atteint le degré de structuration auquel sont parvenus ceux de Kanner pour la plupart peu angoissés quand on les laisse seuls avec leurs objets.
Cependant les autistes pré-kannériens eux-mêmes ne sont pas hors-langage. Lacan le soulignait dès les années 80 : si l’autiste se bouche les oreilles à « quelque chose qui est en train de se parler », observait-il, c’est bien qu’il est déjà dans le post-verbal, « puisque du verbe il se protège » [5] Les énonciations spontanées de certains autistes mutiques confirment pleinement ce constat.
La percussion du langage sur leur corps introduit la dimension d’une perte dans leur espace subjectif. Faute de posséder les moyens de la symboliser l’autiste s’efforce de suturer la béance de l’origine en s’enfermant dans un monde clos sur ses sensations corporelles. L’objet a n’étant pas distancié du sujet celui-ci se fond dans une jouissance autistique. La forme première du bord est une surface de comblement générée à partir du corps lui-même.
Sa construction s’effectue à partir d’autostimulations. « J’avais découvert que l’air était plein de petites taches, relate à cet égard Williams. Si vous regardiez le néant, vous y trouviez des taches. Des gens passaient par là et obstruaient la vue enchanteresse que j’avais du néant ? Je regardais au-delà des gens. Ils dérangeaient ? Je passais outre et me concentrais sur le désir de me perdre dans les taches, en regardant au travers des intrus avec une expression sereine apaisée par la sensation de me laisser absorber toute entière dans les taches […] À la longue, je finis par apprendre à me fondre dans tout ce qui me fascinait, les motifs du papier peint ou du tapis, un bruit quelconque, ou mieux encore, le bruit sourd et répétitif que j’obtenais en me tapotant le menton. » [6] Elle éprouvait, écrit-elle, un plaisir intense à chercher à se dissoudre dans l’espace [7]. Le premier bord prend appui sur ce que Tustin nomme des « sensations-formes » autogénérées, fluctuantes, inclassables et artificiellement créées. Pour nous aider à les concevoir, elle donne l’exemple suivant. « Oubliez votre chaise. Sentez plutôt la pression de votre corps sur le siège. Cela fera « une forme ». Tortillez-vous, la forme changera. Ces formes vous seront entièrement personnelles » [8] Pour l’autiste elles sont répétitives et immuables. Elles tournent éternellement en rond. « L’enfant, précise Tustin, ressentait les mouvements de son corps comme tout-puissants pour produire les formes connues et familières. Il ressentait ces formes elles-mêmes comme toutes-puissantes en ce qu’elles pouvaient lui apporter une sensation d’apaisement et de réconfort, ou, si elles échappaient à son contrôle – par exemple un grand bruit inattendu venant frapper ses oreilles – de choc. Les formes avaient de puissants effets sur ses humeurs. Il régnait en maître sur elles et elles régnaient en maîtresse sur lui. Elles l’ensorcelaient. L’enfant sentait que l’existence de ces formes magiques dépendait de ses activités, et qu’il dépendait lui-même de leur présence magique pour avoir l’impression d’ « exister » [9]. Les caractéristiques principales du bord se discernent dans cette description : il sert à la maîtrise et à l’immuabilité tandis qu’il fait obstacle aux relations sociales. L’effet le plus manifeste est celui que constate d’emblée Kanner : une perturbation du contact affectif.
« Les « sensations-formes », précise Tustin, sont volontiers engendrées par des sensations corporelles douces, telles que l’écoulement de l’urine à l’extérieur du corps, des bulles de salive autour de la bouche, de la salive étalée sur des objets extérieurs, ou encore la diarrhée et le vomi. Tenir un objet extérieur, ou s’appuyer doucement contre, se balancer, tournoyer, ainsi que des mouvements stéréotypés des mains et du corps peuvent aussi produire de telles sensations. Les formes ainsi engendrées sur les surfaces corporelles sont ressenties comme non séparées du corps du sujet […] Non partagées avec d’autres personnes, elles sont, comme les objets autistiques, particulières à l’enfant […] Apaisantes et calmantes, elles constituent une sorte de tranquillisant engendré par le corps » [10] Elles génèrent ce que Tustin nomma une « carapace » ou un « encapsulement » [11] qui réalise une tentative de constitution d’un espace sans trou. Dans cette position, le sujet autiste, souligne E. Laurent, « se jouit sans le trajet de la pulsion qui pourrait articuler son corps à l’Autre. Pure superficie, le corps-carapace est ce qu’il advient d’un corps dont tous les orifices sont bouchés. Dès lors, plus aucun trajet possible » [12] L’autiste non seulement ne veut rien céder de sa jouissance, mais il ne veut rien recevoir. Même les expressions de sympathie ou d’amour à son égard l’inquiètent.
La bulle autistique implique rétention des objets pulsionnels : mutisme, fuite du regard, strabisme, encoprésie et bizarreries alimentaires sont d’une grande fréquence. Le refus de la cession de ces objets est au principe de l’autisme [13]. C’est ce que semble établir la recherche PREAUT en se fondant sur l’hypothèse de M-C Laznik selon laquelle le bouclage du circuit pulsionnel ne s’effectuerait pas. Le bébé autiste ne cherche pas à se faire regarder par sa mère (ou son substitut), en absence de toute sollicitation de celle-ci ; de même qu’il ne cherche pas à susciter l’échange jubilatoire avec l’adulte [14]. Il présente quelques mois plus tard des troubles de l’attention conjointe : il ne s’efforce pas d’attirer l’attention visuelle d’autrui en usant du geste de pointage. Les très jeunes autistes ne sont pas incapables de pointer, mais, quand ils le font, c’est sans utiliser leur regard pour attirer l’attention de l’adulte vers la cible d’intérêt. La cession du regard, comme celle de la voix ou des fèces, tend à être vécue comme déchirante.
C’est à la notion de « carapace » dégagée par Tustin que se réfère d’emblée E. Laurent quand il introduit en 1987 le concept de bord autistique. Cette carapace, écrit-il plus récemment, « fonctionne comme une bulle de protection pour le sujet. S’il n’a pas de corps et donc pas d’image du corps, il a sa capsule ou une bulle très solide qui lui permet de se défendre des manifestations de l’Autre à son endroit » [15]. Pourtant, malgré le retrait massif qu’il génère, le bord corporel obturant reste une défense précaire : il ne peut recouvrir en permanence le traumatisme initial, et celui-ci ne fonctionne pas comme lieu où le sujet pourrait loger son manque. Dès lors « un trou noir » angoissant se manifeste fréquemment ; tandis que le sujet, par des pratiques d’automutilations, peut être incité à produire un lieu de perte où déposer la jouissance en excès qui l’habite. Qui plus est, la carapace protège des manifestations de l’Autre, mais celles-ci n’en restent pas moins menaçantes. Il en résulte que les autistes pré-kannériens sont parfois violents. Ils cassent, déchirent, se mutilent, frappent. « Le monde des autistes qui ne parlent pas, affirme Grandin, est flou, chaotique […] C’est sans doute un peu comme s’il regardait le monde à travers un kaléidoscope, tout en écoutant une radio brouillée par les parasites. Ajoutez-y le fait que le bouton du son est cassé et que les bruits émis passent de façon imprévisible du grondement au chuchotement à peine audible. Les problèmes que connaissent ces autistes sont encore aggravés par l’état de terreur et de panique qui affecte leur système nerveux de façon bien plus grave que pour les autistes du type Kanner. Imaginez-vous dans un état de surexcitation, poursuivi par quelqu’un de dangereux, le tout dans un monde totalement chaotique. Il est peu étonnant que les autistes de faible niveau aient peur d’un environnement qu’ils ne connaissent pas » [16].
Les exceptionnels documents cliniques recueillis par Bettelheim, en étudiant Laurie et Marcia, et par les Lefort, à l’occasion de l’analyse de Marie-Françoise, convergent pour discerner que les autistes pré-kannériens « ont peur, affirme le premier, d’être détruits par tout le monde » [17], tandis que les seconds considèrent que pour eux « le monde est à détruire ou les détruit » [18]. Toute cession d’un objet pulsionnel est vécue comme mutilante, tandis que le traumatisme que tente de recouvrir la carapace reste menaçant, de sorte que la menace d’une castration réelle est omniprésente. C’est ce que Tustin recueille de l’imaginaire d’un enfant autiste comme la présence centrale d’un trou noir. Elle le corrèle à l’absence d’investissement du sein maternel, à sa perte non symbolisée [19], convergeant ainsi avec l’analyse des Lefort selon laquelle l’Autre de l’autiste est sans manque, d’où son caractère menaçant. Faute de symbolisation du manque, une castration réelle s’impose au sujet. Les Lefort insistent sur la perception du corps troué dont témoignent les parlêtres autistes. La première enfant autiste qu’il m’ait été donné de rencontrer en hôpital commençait invariablement les séances en bouchant avec de la pâte à modeler tous les trous de la pièce puis son nombril. Une telle observation n’est pas rare. Les autistes pré-kannériens sont particulièrement préoccupés par les trous, ceux de leur corps, mais tout autant par ceux de leur environnement. Les trous des W-C ou ceux des lavabos suscitent fréquemment leurs inquiétudes. Steve dessine un ovale et déclare « c’est moi ». Quand le clinicien lui signale que cet ovale est vide, il répond : « Je voudrais être comme cela. Pas de nez, pas d’yeux, pas d’oreilles, pas d’anus. Rien ainsi ne pourrait ni sortir ni entrer » [20]. Eric Laurent souligne « une intolérance au trou » chez les autistes [21]. La rencontre de ceux-ci mobilise des angoisses de perte, d’où leur propension à les boucher ; tandis que la mise en jeu d’une perte est ressentie, selon Tustin, comme « un trou noir plein de créatures menaçantes » [22]. Malika le confirme quand, confrontée à un trou dans une chaise, elle se demande, inquiète, « elle va pas sortir la poupée démontée si tu [23] ne bouches pas ce trou-là ? », de sorte qu’elle s’emploie à le combler avec de la pâte à modeler, en commentant « je bouche le trou pour qu’il n’arrive pas de poupée démontée dedans » , elle avait confié en une séance précédente : « perdre son caca, c’est être démontée » et en une autre s’interrogeait : « Quand elle est démontée la poupée, elle a des trous ? ». L’intolérance au trou est corrélative de la propension des autistes à envelopper le corps dans des couvertures, à l’entourer d’une carapace ou à en boucher les orifices.
Etant donné la nature concrète du fonctionnement des enfants autistes, constate pertinemment Tustin, leurs pratiques « semblent faire barrage aux « trous » qui sont le mode prémental sur lequel ils font l’expérience de la perte et du manque » [24]. La fonction du bord consiste certes à faire barrage aux trous, mais la clinique montre qu’ils ne cessent de faire retour. La béance traumatique initiale produite par la marque du langage sur le corps, le bord ne saurait totalement l’obturer, ce dont Williams a l’intuition quand elle confie « avoir toujours eu le sentiment d’un trou noir » entre elle et le monde, de sorte que pour passer de l’autre côté de ce trou noir imaginaire, il lui fallait sauter par-dessus [25]. La carapace n’est pas totalement hermétique : elle travaille à cadrer le trou. Nous soulignerons que la complexification du bord en atteste.
Il est fréquent que la découverte d’un objet cassé ou incomplet leur soit perturbante. Les quelques mots parfois prononcés par les autistes les plus sévères (« brisé, cassé, déchiré, fessé »), les agressions soudaines, les bris et les jets d’objets, les mises en scène violentes (poupées frappées, mordues, tuées, démembrées) révèlent la prééminence des craintes de préjudices et de destructions. Selon les Lefort « quand le réel ne s’articule pas, le petit sujet est troué et l’Autre ne l’est pas, ce qui peut préfigurer que la castration du sujet persiste irrémédiablement dans le réel » [26]. Faute d’inscription d’un manque symbolique au champ de l’Autre les autistes pré-kannériens se perçoivent mutilés ou déchétisés. Ils s’avèrent encombrés par des objets de jouissance dont la cession est vécue comme une castration réelle. Souvent mutiques, le regard mort, ils se bouchent les oreilles, et sont volontiers encoprétiques. Confrontés à un Autre menaçant, ils peuvent être portés à des actes de violence, et à des conduites auto-agressives (se griffer, se mordre, se cogner la tête), voire automutilatoires. Dans un monde aussi dangereux, le retrait dans la carapace s’accompagne le plus souvent d’inertie et de négativité : Williams caractérise un enfant autiste pré-kannérien de « maître du non-être » [27] ; Marcia se dit « une fille forte pour ne rien faire » [28].. Vouloir s’opposer trop directement à ce retrait peut susciter des déchainements de violences. Au moindre mouvement pour l’aider, observe Bettelheim, Marcia « complètement repliée sur elle-même et jusqu’alors inerte, se ruait furieusement en avant, se jetait à notre gorge et essayait de nous étrangler » [29].
Les objets auxquels ils s’intéressent pour traiter la perte dans le réel sont convoqués dans leur concrétude, et non comme représentatifs. Ils brisent et jettent beaucoup, et mobilisent volontiers des oppositions pour chercher à maîtriser le trou : en vidant et en remplissant, en ouvrant et en fermant, en brisant et en réparant, etc. Tantôt ils cherchent à faire advenir un trou dans un monde où la jouissance est en excès ; tantôt ils s’efforcent de maîtriser le surgissement d’un trou en le bouchant ou en l’explorant.
La clinique des autistes pré-kannériens est d’une grande hétérogénéité : elle révèle des positions subjectives très différentes. Abandonnés à eux-mêmes, certains privilégient l’automutilation, d’autres l’inertie, il en est des hyperactifs, des violents, des fugueurs, etc. Tous sont solitaires dans leur carapace, présentent des troubles du langage, et ne font pas de demandes. Les comportements d’immuabilité restent discrets, de sorte que l’un des principaux éléments différentiels avec la schizophrénie infantile est difficile à objectiver. Reste le moment d’apparition des troubles : présents d’emblée dans l’autisme, tandis que survenant chez le schizophrène après un développement apparemment normal pendant les premières années de la vie. Cette distinction reprise par la plupart des manuels contemporains s’avère peu discriminante : il existe des schizophrénies insidieuses, tandis que l’autisme peut n’être décelé que très tardivement. La clinique du pôle pré-kannérien de l’autisme est hétérogène, de sorte qu’elle reste difficile à distinguer des psychoses infantiles.
L’assomption de pertes traumatiques paraît constituer un passage nécessaire pour qu’advienne un bord qui soit plus qu’un bouche-trou : un véritable objet médiateur entre le sujet et l’Autre. Comment y parvenir ? Par le respect des initiatives de l’enfant, selon Bettelheim, en particulier dans le mode de traitement de ses objets de jouissance, fût-ce de laisser lâcher ses excréments dans le bain, ou uriner sur lui-même. Des techniques de conditionnement ne sauraient le tolérer faute d’être en mesure de concevoir qu’elles participent à la construction et à l’évolution du bord le plus fruste. Plus orientés par la structure du parlêtre les Lefort insistent sur la mise en jeu d’un manque par la capacité de l’Autre à faire advenir une demande en sachant ne pas la rabattre sur le besoin.
Bettelheim note comme décisif dans la progression de Laurie le moment où elle commença à déchirer du papier en longs rubans et à en faire des frontières. Ce « furent ses premières activités spontanées, délibérées et, surtout, symboliques. Elles étaient vraiment son invention, sa création à partir de matériaux externes, afin de maîtriser les tensions internes » [30]. Il est remarquable qu’elles se centrent sur le traitement concret d’une perte. Durant des heures, à partir de feuilles de papier, elle produisait de longs rubans en déchirant concentriquement à partir d’un bord jusqu’à ce qu’elle atteigne le centre. Elle perfectionna ce procédé en commençant par un découpage du centre suivi de son rejet accompagné d’une expression de dégoût. [31] Ce noyau de vie « élusif et toujours frustrant » [32] est rapporté par Bettelheim au sein maternel, objet primordial de jouissance. Ce fragment clinique est exemplaire de la construction du bord médiateur à partir d’une élaboration de la perte d’un objet de jouissance.
Le processus emprunte une forme très différente chez David, l’enfant qui suggéra à Tustin la notion de carapace autistique. Cette dernière note que dans les états d’inertie qui caractérisent l’autisme profond, il est remarquable que les enfants n’aient pas de maladie somatique. Dès lors, dans la cure de David, l’apparition d’un abcès à l’index de la main droite semble avoir constitué un tournant. Il s’agit pour lui d’une expérience terrifiante : il le qualifie de « monstre » : du « méchant pus » en a giclé, nommé « jus de mort ». Le phénomène lui évoque une éruption volcanique. Tustin discerne en ce « puissant psychodrame » un moment dynamique qui conduit David à construire lui-même « un monstre » en pâte à modeler afin d’expulser la chose cassée tout en la recouvrant. « Le corps étranger expulsé, note-t-elle, semble emporter avec lui un morceau du sujet ». Quelque temps plus tard, c’est avec une boîte en carton que David élabore une armure protectrice, dont Tustin doit constater, malgré ses préventions concernant l’objet autistique, que le fait de la revêtir constitue un « progrès » dans la cure [33]. L’évolution du parlêtre autiste semble être scandée par des moments de perte maîtrisée. « L’inclusion du nouveau, note E. Laurent, doit s’accompagner de l’extraction d’autre chose. Quand elle peut avoir lieu, cette extraction se produit au travers d’un événement de corps, qui est à considérer, non pas comme effet de signification, mais comme une extraction de jouissance – le sujet parvenant à céder quelque chose de la charge de jouissance qui affecte son corps et ce, sans que cette cession de jouissance lui soit trop insupportable » [34].
Existe-t-il des bornes à l’intérieur du spectre de l’autisme ? Un autiste pré-kannérien peut-il devenir un autiste de haut niveau ? Le témoignage de Tammet le laisse supposer puisqu’il rapporte des conduites précoces et persistantes de violences auto-infligées. « À l’âge de 2 ans, rapporte-t-il, j’avais choisi un certain mur du salon pour m’y cogner la tête de manière répétitive. Balançant mon corps d’avant en arrière, je projetais durement ma tête en avant selon un tempo précis et régulier. Parfois je me cognais si fort que j’en avais des bosses. Mon père accourait pour m’éloigner du mur, dès qu’il entendait le son familier de ma tête contre le mur, mais j’y revenais toujours pour recommencer de plus belle. À d’autres moments, j’entrais dans de violentes colères, je giflais mon visage et je hurlais à pleins poumons » [35]. Comment comprendre de tels mauvais traitements infligés à soi-même ? Selon E. Laurent par la tentative d’opérer une séparation d’avec l’excitation mortelle qui envahit leur corps. Il note une hyperkinésie fondamentale de ces sujets, qui témoigne de leur effort pour éliminer une « chose » qui les encombre afin de faire trou dans la présence menaçante de l’Autre [36]. Sans doute ont-ils accès à une dimension où rien ne manque. « Il n’y a pas de trou, souligne E. Laurent, et rien ne peut donc s’extraire pour être mis dans ce trou qu’il n’y a pas. C’est ce qui provoque chez ces enfants d’incroyables crises d’angoisse, par exemple lorsqu’ils sont face à une porte, ou lorsqu’ils sont aux toilettes et qu’ils ne peuvent se séparer de leurs fœces : dans le registre du réel, il n‘y a pas de trou, sinon celui que tente de créer une automutilation » [37].
Le bord objectal apaisant
Un certain apaisement des conduites s’observe quand s’accomplit un détachement du bord à l’égard du corps et des « sensations-formes » pour prendre consistance dans un objet concret. Avec celui-ci s’introduit une possible focalisation sur un objet scopique permettant à l’enfant de se dégager de l’inquiétante position d’être lui-même cet objet. La logique de « mise en capsule autogénérée » est toujours à l’œuvre puisque l’enfant qui avait conduit Tustin à cette hypothèse avait construit un objet autistique sous la forme d’une armure. Avec celle-ci, note-t-elle, « il ne cherchait pas à se déguiser, comme le font les enfants normaux[…] Il était extrêmement sérieux, comme si c’était pour lui une question de vie ou de mort. Par cet artifice, il avait le sentiment d’échapper au monstre – au « trou » - qui répandait la mort. […] Enfermé dans cette place forte impénétrable que représente l’armure, il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni toucher : les processus d’entrée et de sortie étaient bloqués » [38]. Tustin ne cessa jamais de concevoir l’objet autistique comme un bouche trou néfaste pour la construction du sujet ; elle n’alla pas jusqu’à concevoir les capacités de lien dynamique qu’il peut acquérir. Pourtant David l’avait esquissé au début de la cure quand il avait tenté de vivre dans l’illusion qu’il était relié à sa thérapeute de manière permanente par un cordon ombilical. Celui-ci « faisait partie d’un téléphone qu’il avait réalisé avec de la pâte à modeler et qui représentait la communication physique nous reliant par-dessus le fossé qui nous séparait ». Les interprétations de Tustin, qui n’encourageaient certainement pas la création de ce « cordon ombilical », étaient reçues avec « dédain » et « dérision » [39]. Le fil permettant de communiquer malgré la carapace met en image une certaine porosité du bord, sur laquelle nous reviendrons, car elle s’accentue à la faveur de son évolution. Sa prise en compte est particulièrement importante pour la cure.
Les mutations du bord des sensations-formes à l’objet concret se font progressivement. Les deux aspects peuvent coexister tandis que la même logique de comblement de trous menaçants apparaît à l’œuvre. L’observation de Susie semble l’indiquer quand elle fut découverte, endormie, cachée sur une couverture, « enroulée sur elle-même, le pouce dans la bouche, les deux autres doigts dans les narines, tandis que l’autre pouce est profondément enfoui dans son anus ». Tous les accès à sa personne étaient obstrués. Elle n’avait pas pour autant lâché son objet autistique, un poisson, qu’elle tenait toujours dans la main gauche [40].
Pour les autistes kannériens, l’intolérance au trou se fait plus discrète, parfois même elle disparaît. La présence de l’objet s’affirme : son décollement du corps s’accentue.
Kanner fut frappé par la différence de traitement opérée entre les objets et les personnes par les autistes qu’il observa. Tous les enfants, en entrant dans son bureau, allaient immédiatement vers les cubes, les jouets ou les autres objets, semblant ne prêter aucune attention aux personnes. À la condition de ne pas entraver leur relation aux objets, il pouvait jouer joyeusement avec eux pendant des heures. Aujourd’hui nombreux sont ceux qui ne se détachent plus de la télévision, qui regardent en boucle le même film, qui s’absorbent dans des jeux vidéo et qui ne s’intéressent qu’à des personnages issus de ces univers fictifs. D’autres interminablement manipulent des billes, triturent le sable ou classent des objets.
Ces derniers ne sont plus essentiellement utilisés pour des activités d’autostimulation : leur maniement est apaisant et rassurant. Un écart avec eux s’est opéré : le sujet ne cherche plus à les incorporer. Le bord permet de localiser la perte et de la maîtriser. La béance de l’Autre peut être obstruée à volonté par son entremise. Si le psychotique a l’objet a dans sa poche ; l’autiste, lui, l’a plutôt à sa main.
Outre les satisfactions obtenues par leur compagnie, la fascination qu’ils suscitent sert de truchement pour l’acquisition de connaissances. « Je me passionnais pour les classements et collections en tous genres, témoigne Williams. Je rapportais à la maison les ouvrages spécialisés de la bibliothèque qui traitaient des différentes espèces de chats, d’oiseaux, de fleurs, de maisons, de travaux artistiques – en fait tout ce qui pouvait faire partie d’ensembles plus vastes et trouver sa place dans une hiérarchie classificatrice […] Ma passion des classements ne s’arrêtait pas aux encyclopédies. Quand je lisais l‘annuaire, je comptais soigneusement le nombre de Brown, ou encore le nombre de variations autour d’un nom particulier, à moins d’établir le compte exact des noms rares… J’explorais à ma manière les concepts d’uniformité, de conservation et de cohérence » [41].
Le maniement des objets apaisants s’articule souvent aux conduites d’immuabilité. « J’adorais copier, fabriquer et mettre en ordre tout et n’importe quoi, rapporte Williams. J’avais une prédilection pour la série de volumes de notre encyclopédie. J’étais toujours en train de vérifier si les lettres et les chiffres qu’ils avaient sur la tranche étaient dans le bon ordre, et je rectifiais en cas de besoin. C’était ma façon de créer de l’ordre à partir du chaos. » [42] […] Je recherchais simplement un monde de cohérences bien pourvu en références fixes. Le changement perpétuel qu’il fallait affronter partout ne me donnait jamais le temps de me préparer. C’est pourquoi j’éprouvais tant de plaisir à faire et refaire toujours les mêmes choses » [43].
Le bord apaisant n’est pas nécessairement constitué par des objets matériels : un parent, un frère ou une sœur peuvent en tenir lieu, mais à la condition que ce soit des personnes prévisibles et donc maîtrisables. « Pour moi, souligne Williams, les personnes que j’aimais étaient des objets, et ces objets (ou les choses qui les évoquaient) étaient ma protection contre les choses que je n’aimais pas, c’est-à-dire les autres personnes ». Pourquoi un tel besoin de protection ? En raison, témoigne-t-elle, d’une « peur irrépressible de [sa] propre vulnérabilité » [44].
Quand le bord se concrétise, outre l’objet autistique, deux autres éléments peuvent s’y agréger pour œuvrer à son développement : l’image du double et l’intérêt spécifique. À la faveur de la complexification du bord ces éléments deviennent plus ou moins interdépendants.
Un investissement prévalent des objets caractérise tous les autistes de Kanner, mais beaucoup témoignent de surcroît d’une aptitude à acquérir des connaissances remarquables grâce à une mémoire exceptionnelle (noms et classifications d’animaux, chansons, prières, nombres). Ces intérêts spécifiques sont d’abord utilisés pour se protéger de l’Autre en l’assommant par un étalage interminable de connaissances.
Le bord apaisant tempère le rapport à l’Autre : les violences et les automutilations deviennent rares, sauf précisément si l’on cherche à y porter atteinte ou si l’on tente d’entraver les comportements d’immuabilité associés. Il constitue une protection efficace contre le désir de l’Autre mais toujours au prix de grandement entraver les relations sociales. Sa mise en place témoigne de l’assomption d’une perte dans l’économie subjective : l’autiste situe la jouissance pulsionnelle dans un objet hors-corps qui la capte. Cette perte n’est plus associée à un vécu de mutilation quand le sujet garde la maîtrise du bord. À partir de celui-ci, des acquisitions scolaires et sociales commencent à pouvoir se développer, tandis que le corps se structure.
Le bord dynamique
Le bord apaisant est en général trouvé par le sujet dans son environnement ; le bord dynamique est plus complexe : il implique une participation du sujet à sa construction. Si l’on s’attache à suivre pas à pas la relation du parcours de Joey à l’Ecole orthogénique de Chicago, on constate qu’il trouve des solutions de plus en plus efficaces pour tempérer son angoisse et construire son monde, et que celles-ci s’appuient sur une succession d’objets dont les caractéristiques se modifient. Après avoir été captivé très tôt par les ventilateurs, il se présente à Bettelheim comme un « enfant-machine », puis il s’attache à Ken, qu’il nomme Kenrad, en référence à une puissante lampe qui lui confère de énergie. L’appréhension que Joey se fait de lui s’humanise alors progressivement, ce dont témoignent ses représentations de lui-même, sur des dessins, en « papoose » [45], d’abord électrique, puis de plus en plus humain. Vient ensuite un nouvel objet complexe, incarné dans un autre garçon de l’Ecole, Mitchell, le plus normal d’entre eux selon Bettelheim. Mitchell n’est plus une lampe. Joey crée pour ce garçon et pour lui-même une famille, la famille « Carr ». Plus tard apparaît un compagnon imaginaire nommé Valvus, un garçon à l’image de Joey. La construction de celui-ci fait peu à peu disparaître les machines, tandis que Kenrad et Mitchell sont oubliés. L’élection de chaque nouvel objet implique assomption d’une perte progressive des précédents permettant ainsi une prise en compte du trauma très tempérée. Plus tard, après avoir terminé ses études secondaires dans un lycée technique, en se spécialisant dans l’électronique, Joey revint à l’Ecole orthogénique porteur d’une machine électrique qu’il avait construite, un redresseur dont la fonction était de changer le courant alternatif en courant continu, c’est-à-dire une machine capable de réguler l’énergie électrique, ce dont précisément il imaginait avoir besoin en arrivant dans cette Ecole.
La machine électrique de Joey et ses constructions ultérieures, les compagnons imaginaires de Williams, la trappe à serrer de Grandin sont des exemples du bord dynamique ; mais sa forme la plus fréquente réside dans le développement d’un intérêt spécifique. La prévalence de celui-ci est ce qui caractérise les autistes savants et les autistes d’Asperger : il ne ferait défaut chez ces derniers que dans 5% à 15% des cas [46].
L’intérêt spécifique trouve souvent son origine dans un travail pour lutter contre un objet d’angoisse en cherchant à le maîtriser par la connaissance. « Plusieurs patients, rapporte Attwood, m’ont décrit comment quelque chose dont on a peur pouvait se transformer en intérêt spécial. La peur du bruit des chasses d’eau des toilettes peut évoluer vers une fascination pour la plomberie ; une forte sensibilité auditive au bruit de l’aspirateur peut déboucher sur une fascination pour les différents types d’aspirateurs, leur fonctionnement et leur utilité. Je connais plusieurs filles Asperger, poursuit-il, qui avaient très peur du tonnerre, et qui ont développé un intérêt spécial pour les stations météorologiques afin de prédire les orages imminents. Liliana, une adulte Asperger, a décrit comment, dans son enfance, elle avait peur des araignées, mais qu’elle avait décidé de surmonter sa peur en lisant tous les livres qu’elle pouvait trouver sur les araignées, finissant par chercher les araignées pour les étudier. Matthias m’a expliqué dans un e-mail que « Quand je suis rempli de peur ou me sens troublé, j’ai tendance à parler des systèmes de sécurité, l’un de mes intérêts spéciaux ». [47] La machine de Joey devait essentiellement réguler la cession de l’objet anal, la trappe à serre de Grandin chercha à rendre la mort plus supportable, l’intérêt d’Ouellette pour la musique lui permit de supporter les violences subies à l’école [48], Williams note que l’énergie sans limites de ses compagnons imaginaires trouve sa source dans « l’angoisse et la panique » [49], etc. Bref, le bord dynamique semble être le plus souvent issu d’un travail pour composer avec un objet traumatique. Il ne décomplète pas l’Autre : il traite la perte par l’imaginaire. Il prend sa source soit dans un voile porté sur l’objet traumatique, soit dans une maîtrise de celui-ci par la connaissance, voire dans une combinaison des deux approches.
Le bord dynamique est souvent contemporain du développement de jeux de cache, de jeux de présence-absence, ou de connexion-déconnexion. La captation d’un objet traumatique confère au bord une remarquable aptitude à dynamiser le sujet, mais à la condition qu’il se connecte volontairement à lui. On sait que lorsque Joey se branchait imaginairement sur sa machine il s’animait ; tandis que lorsqu’il se débranchait il devenait sans vie. Grandin doit user de sa trappe pour réguler son énergie vitale. L’un des compagnons imaginaires de Williams est ’une incarnation extérieure’, forgée à partir d’un cadrage de l’objet regard. ’Ce Willie, écrit-elle, ça n’était qu’une paire d’yeux verts luisant dans l’obscurité, mais quels yeux ! Ils me faisaient bien un peu peur ces yeux-là, mais je m’étais dit qu’en retour je leur inspirais la même crainte’ [50]. Grâce à Willie l’objet traumatique est voilé, mais aussi maîtrisé, car Donna peut le perdre et le récupérer à volonté. Si elle se branche sur lui, une animation pulsionnelle s’opère. Willie était toujours en colère, il avait de fortes idées, il raisonnait, analysait et cherchait à écraser l’interlocuteur sous le poids de ses arguments. C’était ’une créature au regard flamboyant de haine, à la bouche pincée, aux poings serrés, arborant une posture à la rigidité cadavérique. Willie tapait du pied et crachait à la moindre contrariété’. Or l’incarnation de ce double lui a permis de faire de bonnes études universitaires.
Le bord dynamique est souvent associé à des conduites de branchement-débranchement volontaires qui témoignent d’une aptitude à une négativation temporaire de l’objet. Le cadrage initial d’un « trou noir » par le bord rend celui-ci apte au creusement d’un manque où le sujet peut trouver à se loger, d’où le curieux sentiment donné par le bord dynamique selon lequel il serait le lieu d’insertion de la libido.
L’effacement du bord
Certains autistes mettent même en scène sa perte réelle. Williams souffrit longtemps de la présence de ses compagnons imaginaires qui lui permettaient certes une adaptation sociale mais qui faisaient persister un certain vécu de « mutilation psychique » quand elle se branchait sur eux. C’est pourquoi elle discerna que son évolution devait passer par la disparition de la « partie d’elle-même » qu’ils représentaient. À l’adolescence, elle tenta de se séparer de Willie. Je décidai de tuer Willie, écrit-elle, cet autre moi-même toujours en colère. « On m’avait donné, relate-t-elle, une poupée figurant un petit garçon vêtu d’un jean et d’une chemise. Je l’enroulai dans un morceau de tissu rouge écossais, une étoffe qu’affectionnait ma grand-mère. Je colorai ses yeux au crayon de couleur, afin de lui donner un regard lumineux d’un vert irisé et phosphorescent ». Notons cette indication qui confirme le cadrage de la jouissance scopique opéré par Willie. « Je me procurai, poursuit-elle, une petite boîte en carton que je peignis en noir. J’attendis qu’il n’y eût plus personne à la maison, puis je partis vers l’étang aux poissons où j’immergeai ma personnification symbolique de Willie dans son noir cercueil, effaçant minutieusement toute trace des funérailles » [51]. Ce meurtre imaginaire ne parvint pas à ses fins : il fallut encore de longues années avant que sa disparition ne soit assumée, mais il révèle une orientation de l’auto-thérapie mise en œuvre par certains autistes de haut niveau.
Dibs la confirme quand il achève sa psychothérapie par une capture de sa voix et une mise en scène de sa perte. « Ecoute-moi bien, magnétophone, dit-il. Tu vas attraper et garder ma voix. … Je vais faire un long enregistrement et nous le garderons pour toujours et pour toujours. Ce sera juste pour nous deux » [52]. Au terme il insiste sur le fait que sa psychothérapeute doit garder l’enregistrement : rangez cette bande, lui dit-il, « mettez la dans la boîte et rangez la, et gardez la juste pour nous deux » [53]. Cette assomption d’une cession de jouissance s’accompagne d’une mise en jeu de la dimension du manque dans son rapport à l’Autre. Il sait que les vacances d’été vont interrompre sa psychothérapie qui touche à sa fin. « Vous allez me manquer, dit-il à sa thérapeute. Ça va me manquer de ne plus venir ». Il ajoute : « Est-ce que je vais vous manquer ? » [54]. Quelque chose peut maintenant manquer au sujet comme à l’Autre, et pourtant ce n’est pas perdu, mais capté par un contenant qui reste accessible. Deux ans et demi après l’achèvement de la cure, quand sa thérapeute rencontre Dibs, elle constate qu’il développe un îlot de compétence dans le domaine de la botanique, dérivé de l’arbre qui fut l’un de ses objets autistiques.
Grandin semble mettre en scène un traitement de sa propre perte quand elle se glisse dans sa trappe à serrer qui, selon elle, trouve sa source dans « une sorte de boîte ressemblant à un cercueil » [55], cependant elle précise que le plus important était qu’elle « reste maître à bord » [56] quand elle s’en servait. Grandin conserva pendant de longues années dans sa chambre à coucher un objet qui lui servait à réguler sa jouissance par une conduite volontaire. Ce n’est que tardivement, en 2010, qu’elle mentionne que sa machine s’est cassée et qu’elle ne l’a pas réparée. « Maintenant, dit-elle, c’est avec les gens que je fais des câlins » [57].
Une modification de la position subjective de l’autiste passant par l’assomption d’une perte de contrôle majeure peut prendre des formes plus concrètes. La décision de Tammet de quitter ses parents pour aller enseigner un an à l’étranger constitua de son propre aveu un tournant décisif de son existence. Bien après la tentative de meurtre de Willie, Williams témoigne que de lâcher le manuscrit de son premier livre pour le livrer à la publication, révélant ainsi l’intime de son monde intérieur, n’alla pas sans angoisse, mais fut aussi une avancée.
Les rares autistes qui accèdent à la rencontre de partenaires sexuels semblent être parvenus à un effacement de la concrétude du bord. Ils ne gardent plus une trappe à serrer dans leur chambre à coucher ; mais ils peuvent conserver discrètement dans leur poche un objet qui les aide à fonctionner. « Pour ma part, témoigne Nazeer, je sors rarement sans une pince crocodile dans ma poche, bien que depuis peu mon téléphone portable fasse office de substitut ». Cet objet sert à la régulation de son attention et de son comportement. « Je joue avec la pince, précise-t-il, pour avoir un objet sur lequel me concentrer pendant que j’essaie de faire quelque chose de plus difficile » [58]. Elle lui apporte ce qu’il nomme « de la cohérence locale » [59]. D’autre part, Nazeer est socialement branché avec discrétion sur un double dynamique, le ministre dont il écrit les discours [60]. Un de ses amis autiste utilise le même procédé : pour s’exprimer Graig rédige le discours d’hommes politiques [61].
Le bord dynamique ne disparaît pas : il s’efface. Le branchement sur lui peut devenir moins permanent. Gerland rapporte en avoir encore besoin seulement pour initier ses conduites. « Très souvent, écrit-elle, c’est plus facile si j’ai quelqu’un avec moi lorsque je dois faire quelque chose pour la première fois, car je peux, en quelque sorte, me fier à son système nerveux. À cet effet, je me suis presque servi des gens. J’ai pu faire semblant de demander leur compagnie alors qu’en réalité, j’avais besoin d’une escorte. Je me suis arrangée pour emmener quelqu’un avec moi pour visiter un musée ou une galerie où je n’étais jamais allée auparavant dans le seul but de pouvoir y retourner seule plus tard sans difficulté. Parfois, j’aurais aimé, telle qu’un ordinateur dans un réseau, pouvoir me brancher sur le système nerveux de quelqu’un d’autre pour m’en servir dans de telles circonstances, au lieu de devoir l’emmener avec moi, et d’être obligée de le rencontrer et d’agir en même temps » [62]. Un objet, plus maîtrisable, lui aurait mieux convenu qu’une personne pour incarner ce bord temporaire, mais si la personne partage avec l’objet autistique complexe une fonction dynamique, elle présente de surcroît l’avantage de servir de modèle, d’où malgré tout le choix de faire intervenir un branchement humain.
Le bord dynamique reste souvent localisé dans un modèle ou dans un proche. L’élaboration d’une cession de jouissance à partir d’une perte d’éléments du bord ouvre parfois à la possibilité de rencontres de partenaires sexuels. Ceux-ci peuvent encore se prêter à un traitement de la perte. La majorité des autistes qui sont en couple vivent avec un autre autiste, ou bien avec un compagnon homosexuel. Ils cherchent un partenaire qui soit un double afin de gommer la différence et la perte qu’elle implique. Rares sont ceux qui parviennent à connaître la jouissance sexuelle. Williams constate qu’elle ne lui a été rendu possible qu’à l’occasion de ses premières rencontres sentimentales avec des partenaires non autistes : d’abord avec Mike, puis avec une femme, Shelly, et avec son second mari, Chris [63]. Sans doute un écho en son corps d’un traitement de la castration plus élaboré.
Persistance d’une scission subjective
Carol et Willie, les deux éléments du bord dynamique de Williams, lui fournissaient une « protection anesthésiante » [64] qui lui permettait de « supprimer » l’émotion [65]. En s’effaçant, ils n’ont pas totalement disparus : ils se sont introjectés. « Je ne les ai pas rejetés, affirme-t-elle, ils se sont désintégrés (ou réintégrés ?). J’ai accepté leurs capacités… » [66] Elle précise même que « l’ancienne Carol » s’est intégrée à Donna Williams [67]. De surcroît, en un moment d’angoisse, il arrive que Willie fasse spontanément retour bien après son « meurtre » [68].
Quand le bord se complexifie, les objets autistiques concrets deviennent discrets, voire disparaissent, l’appui sur un double s’avère moins nécessaire, l’intérêt spécifique se fond dans une compétence sociale ; pourtant le bord subsiste dans sa forme première de carapace sous forme d’une scission entre la vie émotionnelle et le fonctionnement intellectuel. Lorsque Donna Williams cherche à saisir ce qui différencie la schizophrénie de l’autisme, quand elle tente de définir ce qu’il y a de plus caractéristique dans son fonctionnement, elle note : « fondamentalement la solution que j’avais trouvée pour réduire la surcharge affective et permettre ainsi ma propre expression consistait à combattre pour, et non pas contre la séparation entre mon intellect et mes émotions » [69]. Les enfants autistes, précise-t-elle, sont « secrètement piégés dans une affectivité mutilée » [70] ; ils « ont des sentiments et des sensations, mais qui se sont développées dans l’isolement. Ils ne peuvent pas les verbaliser de façon normale » [71]. « Le cerveau, confirme Harrisson, ne reçoit pas les messages du corps, même si le cerveau et le corps font leur travail chacun de leur côté » [72]. Le développement de l’intellect semble se produire indépendamment des émotions, faisant d’eux, selon Asperger, « des automates de l’intelligence » [73] ; tandis que les passions des autistes s’attachent au bord et à ses éléments : l’objet autistique, le double, et l’intérêt spécifique.
Même chez les autistes de haut niveau, le refus de l’expression de sentiments de sympathie ou d’amour à leur égard reste caractéristique de leur fonctionnement. « En ce qui me concerne, constate Williams, ma raison me dit bien que l’affection et la gentillesse ne me tueront pas. Cependant, ma réaction affective défie cette logique en me signifiant que les émotions les plus douces, les sensations les plus chaleureuses peuvent me tuer, ou du moins me faire souffrir. Quand j’essaie d’ignorer ce message, j’entre dans un état de choc où tout ce qui advient me devient incompréhensible ou vide de sens ». Si la jouissance d’un sujet se localise là où il constate que quelque chose de plus fort que lui s’impose à sa volonté, il est manifeste que pour l’autiste de haut niveau elle se situe dans une scission subjective qui génère ce que Williams nomme « une prison affective » [74]. Tenter de déborder la défense suscite un état d’angoisse qui déstructure la perception.
Quand les objets qui soutiennent le bord s’effacent, que le fonctionnement pulsionnel s’assouplit, et que l’énonciation s’affirme, subsiste malgré tout un bord « carapace » qui se manifeste par une scission entre un espace subjectif intime, secret, dont la jouissance doit restée inentamée, propice au développement d’une langue privée, verbeuse, et un espace subjectif social, qui se développe en prenant appui sur une langue de signes, ou de lettres signalétiques, pour l’essentiel apprises par cœur, formant un Autre de synthèse. Les autistes de haut niveau insistent sur l’apprentissage par cœur et par éléments de ce dernier, soulignent sa difficile subjectivation, et son peu de connexions à la vie émotionnelle. Avec celui-ci beaucoup affirment penser leur vie et vivre leur pensée [75]. En revanche, dans l’espace subjectif intime se développe volontiers une langue verbeuse qui prend appui sur la lalangue : elle prend parfois l’allure, même chez des autistes de haut niveau, d’un « langage de poète » [76], elle se caractérise de n’être guère adressée. Elle reste pour l’essentiel cantonnée à des productions servant une satisfaction privée (soliloques, poèmes, inventions de langue) ; dans quelques cas elle se hausse au niveau de communications allusives [77]. Une des formes les plus élaborées en est le Mânti de Tammet, création d’une langue néologique, qui ne peut servir à la communication, mais qui lui sert à trouver des mots pour exprimer ses expériences particulières [78]. Une langue bien à lui qui exprimerait authentiquement quelque chose de lui-même tout en restant opaque à un éventuel auditeur. Sa formidable mémorisation de langues étrangères dans son espace subjectif social est d’un tout autre ordre : elle prend appui sur des lettres signalétiques coupées de ses émotions.
La scission entre langue factuelle pauvre en affects et langue verbeuse riche en émotions n’a pas manqué de frapper les cliniciens : « souvent, constate Hébert, quand ils parlent, les autistes le font d’une voix atone , mécanique, comme si en effet la part musicale de la langue était dissociée du sens, comme s’ils avaient le choix entre parler sans musique ou faire des sons sans sens : sens brut ou son brut, code informatif ou émotion sensitive, mais jamais les deux articulés » [79].
Les énonciations spontanées qui parviennent à franchir la carapace, en passant la barrière du mutisme, attestent que très tôt le bord peut se traverser. De surcroît on sait que la bulle autistique n’est pas hermétique : même les autistes les plus repliés en leur monde restent attentifs à ce qui les entoure. Il arrive que certains acquièrent des connaissances étonnantes à l’insu de leurs proches. Si la fonction initiale du bord est d’instaurer une protection contre une béance traumatique qui s’est ouverte dans l’espace de jouissance, il reste connecté à un trou qu’il ne parvient jamais totalement à effacer, et même qu’il inclut en le bordant.
Les éléments objectaux qui contribuent à la complexification du bord prennent appui sur une cession de jouissance : le double implique une perte en tant qu’il n’est jamais totalement identique au sujet, l’objet autistique témoigne qu’une extraction de jouissance de la surface du corps s’est produite, quant à l’intérêt spécifique, il est toujours incomplet, suscitant un désir d’en savoir plus, voire d’acquérir de nouveaux objets. Se produisant à la faveur de sauts créatifs qui trouvent leur source dans une cession de jouissance, l’évolution du bord implique accentuation de ses ouvertures, en témoigne une progressive instauration du fonctionnement pulsionnel : le regard fuit moins, la défécation se régule, l’oralité est moins contrainte, l’énonciation s’affirme.
Cependant les énonciations subjectivées qui se manifestent chez des autistes de haut niveau sont précédées par divers phénomènes qui témoignent que la traversée du bord par l’énonciation ne se fait pas sans retenue. Quand il cesse de la bloquer, elle peut se manifester par l’écrit, par des propos allusifs, passer par une langue étrangère, elle peut être détournée sur un double, elle peut se limiter à des propos techniques, etc. Un enfant autiste qui se met à parler de manière plus subjectivée à la faveur de l’évolution de sa cure confie à son thérapeute : « Je ne parle jamais de moi. Je n’aime pas qu’on se mêle de moi […] je n’ai rien à dire de moi et si j’avais quelque chose à dire, je ne le dirais jamais ». Il ajoute qu’il « ne parlerait pas sous la torture » [80]. Les énonciations subjectivées ne surgissent pas d’emblée : elles sont tributaires d’un long travail de complexification du bord qui rend sa traversée plus aisée. De surcroît elles témoignent d’un franchissement de la scission entre espace subjectif intime et espace social mais non de la disparition de celle-ci. Jusque dans leurs manifestations les plus hautes la barrière instaurée par le bord reste longtemps active. Quand Williams cherche à remercier tous ceux qui ont fait des efforts pour l’aider, et pour aider d’autres autistes, il lui faut encore employer de grandes précautions pour atténuer la charge affective. Elle en passe par l’écrit pour affirmer : « Le leur dire d’une façon indirecte et détachée n’est pas synonyme d’indifférence » [81].
L’effacement du bord s’accompagne le plus souvent d’un développement de l’intérêt spécifique. Un imaginaire de « carapace » peut cependant continuer à lui être attaché : « je me sentais heureux, peut confier Tammet, entouré par les nombres, comme enveloppé par une agréable couverture numérique » [82]. L’une des caractéristiques de l’intérêt spécifique est l’accumulation de connaissances et d’expertises, de sorte que son développement dans l’espace subjectif social peut donner naissance à une compétence, propre à permettre l’entrée dans une carrière professionnelle ou universitaire.
Quand le bord s’efface, l’autiste n’a plus l’objet a à sa main, un voile peut être porté dessus, une vie amoureuse devient parfois possible. Toutefois la plupart des autistes conservent un comportement « réservé », insistent sur la persistance d’une voix « demi-étranglée » et de troubles sensoriels (l’espace parfois se déstructure, les sons varient en intensité, etc.), lesquels témoignent de la permanence d’un fonctionnement du bord, même chez les sujets les plus exceptionnels. Une des conséquences en est la persistance d’une difficulté avec les équivoques et le développement d’une compétence sociale à partir de lettres signalétiques qui n’a pas les propriétés du sinthome. L’investissement libidinal qui préside à la création et au développement de l’Autre de synthèse reste bridé par le bord.
L’accentuation des ouvertures de ce dernier par sa complexification facilite sa traversée, ce dont témoigne l’instauration d’un fonctionnement pulsionnel ; toutefois celui-ci reste marqué de précarité et d’intermittences à des degrés divers ; c’est une des raisons majeures pour lesquelles les autistes de haut niveau affirment que leur fonctionnement persiste à rester autistique.
Le pôle invisible de l’autisme
L’effacement du bord génère ce que certains ont pu nommer le pôle invisible de l’autisme, qui s’étend dans l’au-delà de la clinique d’Asperger. On y rencontre des sujets qui n’ont parfois découvert le nom de leur différence que tardivement : Gunilla Gerland est une jeune adulte quand elle identifie son autisme dans un livre [83], Ouellette a 47 ans quand le diagnostic est posé à la suite d’une consultation pour anxiété et insomnies [84]. Il est fort probable qu’un certain nombre d’autistes ne sont jamais diagnostiqués comme tels.
« Peut-on souffrir d’autisme, s’interroge un spécialiste, sans que ce trouble fonctionnel ait été décelable dès l’enfance et l’adolescence ? Existe-t-il des formes assez faibles pour qu’on ne réussisse pas à les diagnostiquer à temps ? Les formes atténuées d’autisme sont-elles graves au point d’entraîner de grands handicaps ? Le handicap est-il tel que les troubles fonctionnels passeront pour de l’indiscipline, du désordre, du repli sur soi, de la malignité ou même de la méchanceté ? La réponse à ces questions, affirme C. Gilberg, est « oui » sans réserve » [85]. Il appuie sa conclusion sur le témoignage de Gerland. Celui de Ouellette montre qu’il existe des autistes moins handicapés par leur mode de fonctionnement ; ils sont souvent maltraités par leurs camarades de classe qui se moquent de leur différence.
De surcroît la pertinence de l’opinion de Gilberg se trouve étayée par une observation clinique bien connue, très étudiée par les psychologues, pour laquelle le diagnostic d’autisme n’a pourtant quasiment [86] jamais été évoqué. Il s’agit de Cherechevski, le mnémoniste de Luria, observé par lui pendant une trentaine d’années.
« Les lois connues de la mémoire ne pouvaient s’appliquer » chez ce sujet, constata le psychologue russe, de sorte qu’elle ne saurait être étudiée que « rapportée à sa structure psychique » - mais sur la nature de celle-ci il resta évasif. Or les exceptionnelles caractéristiques de la mémoire de Cherechevski sont analogues à celle de Daniel Tammet. Ce dernier lui-même en atteste. « Comme moi-même, écrit-il, Cherechevski pouvait visualiser les chiffres et les mots, et mémoriser d’immenses quantités d’informations » [87]. Tous deux possèdent une perception synesthésique des chiffres et des mots. « Les nombres, écrit Tammet, m’apparaissent comme autant de formes, de couleurs, de textures et de mouvements. Le nombre 1, par exemple, est d’un blanc brillant et éclatant […] Quatre est un coup de tonnerre ou le son des vagues qui se brisent sur le rocher. Trente-sept est grumeleux comme du porridge, alors que 89 me rappelle la neige qui tombe » [88] Pour Cherechevski, « 1 est un chiffre pointu, indépendamment de sa représentation graphique, c’est quelque chose de fini, de dur ; 2 est plat, rectangulaire, blanchâtre, parfois grisâtre ; 3 est un tronçon aiguisé qui tourne ; 4 est rectangulaire lui aussi, obtus, il ressemble au 2 mais en plus important et gros. 5 est absolument parfait, en forme de cône, de tour, il est solide ; 6 c’est le premier après 5, blanchâtre ; 8 est inoffensif, d’un bleu laiteux, ça ressemble à de la chaux, etc. »
La communauté de fonctionnement d’une mémoire exceptionnelle échappant aux lois connues de celle-ci, en particulier non affectée par le refoulement, ne suffit certes pas à établir la structure autistique de Cherechevski. En revanche le fonctionnement de sa pensée qui prend appui sur des signes iconiques est très caractéristique de certains autistes. Il affirme ne comprendre que ce qu’il voit, de sorte que son esprit transforme automatiquement les mots en signes visuels [89]. Des conséquences immédiates en découlent : une volonté de réduire le langage à un code, une difficulté avec les mots abstraits, une prise des métaphores à la lettre.
Cherechevski est embarrassé quand un même objet est nommé par des termes différents : il ne peut se résigner à ce que les termes « truie » et « porc » désignent le même animal. De manière semblable Williams témoignait savoir ce qu’étaient des vaches, mais quand elles devenaient un troupeau elles cessaient pour elle d’être des vaches [90]. « Je n’aime pas, affirme Tammet, quand les mêmes mots peuvent renvoyer à deux choses totalement différentes » [91]. Les autistes voudraient, comme le souligne Nazeer, un codage faisant correspondre chaque sens à un mot [92]. Luria fait pertinemment état d’un « codage en images » concernant la pensée de Cherechevski [93], lequel se déclarait « traditionnaliste quant aux mots » et s’étonnait que les gens « appliquent si habilement les mots dans plusieurs domaines » [94].
Ce dernier confiait que les termes abstraits lui étaient d’une compréhension difficile : les notions d’infini ou de négation de la négation lui étaient presque inaccessibles. Néanmoins, quand il le peut, il les traite d’une manière bien explicitée par Grandin : pour se représenter la paix, elle convoque un signe iconique, une colombe ou un calumet. Pour appréhender la complexité Tammet doit générer l’image mentale d’une tresse ou d’une natte. Cherechevski, lui, fait de la maladie « un brouillard qui émane de la personne et qui l’enveloppe » [95].
Il relate par ailleurs sa propension à prendre à la lettre des expressions telles que « peser les mots », « fendre le cœur », ou « le vent rabattait les nuages ». [96]. On sait qu’une telle opacité à la métaphore est couramment rencontrée dans la clinique de l’autisme.
Malgré ses exceptionnelles capacités mnémoniques, le sujet observé par Luria peine à mémoriser les visages. La plupart des autistes témoignent de cette même difficulté et en donnent la même explication : « Ils sont tellement inconstants, disait Cherechevski, ils varient selon la disposition d’esprit au moment de la rencontre ; ils changent constamment de couleur, se brouillent et il devient difficile de se les rappeler » [97]. Tous les autistes constatent que la variabilité des visages dresse un obstacle au travail de codage du monde.
D’autre part, Cherechevski fait état dans son enfance d’une ébauche de création d’un compagnon imaginaire, qui n’est pas à concevoir comme un « dédoublement de personnalité », note pertinemment Luria, mais plutôt comme un « rejet » de sa propre personnalité. Il ajoute que le fait de transférer « ses propres sensations et actes sur l’ « autre » qui agit sur « mon » ordre peut dans certains cas contribuer dans une grande mesure à une régulation automatique du comportement » [98]. Ce qu’illustrent assurément les compagnons imaginaires de Williams.
Elfakir souligne que la recherche expérimentale de Luria, qui a duré presque une trentaine d’années, n’a pas été sans influencer la trajectoire de vie de Cherechevski. Cette longue période d’expérimentation lui a fourni « les moyens pour corriger un certain nombre de lacunes sur le plan de la remémoration et, plus généralement, acquérir une stabilisation au niveau de son existence », en devenant mnémoniste professionnel, et en acquérant ainsi une certaine célébrité. Il semble qu’il ait puisé dans son étroite relation avec Luria une orientation de son existence. Qu’il ait probablement toujours eu besoin de s’étayer sur un double pour fonctionner, Elfakir en décèle l’indice dans le devenir de Chereveski après la fin de l’expérimentation. « « Il ne pouvait que redevenir simplement ce qu’il avait été : un être toujours en attente qu’un événement heureux ou qu’un personnage intentionné vienne à sa rencontre, le prenne par la main et le soutienne comme son double. Se laissant porter par ces rencontres, il occupera tour à tour diverses activités : figurant au cinéma, thérapeute traditionnelle, directeur d’imprimerie, organisateur du travail dans les entreprises, etc. » [99].
Outre une discrète persistance du double dynamique, l’effacement du bord par intériorisation d’une scission entre un espace subjectif privé et un espace social se laisse discerner. Tout indique que la vie émotionnelle de Chereveski restait contenue. En témoigne le surnom d’ « âme froide », en yiddish « Kalter Nefesch » qu’on lui attribuait [100]. De surcroît Luria ne manque pas de constater une scission dans son fonctionnement se manifestant par un investissement d’un univers imaginaire en corrélation avec un retrait du monde réel. « Il avait une famille, écrit-il, une bonne épouse, un fils doué, mais tout cela ne lui parvenait qu’à travers une espèce de brume. Et il serait difficile de dire ce qui avait pour lui le plus de réalité : son univers imaginaire dans lequel il vivait, ou le monde réel dans lequel il n’était qu’un passant… » [101].
Luria s’est plus intéressé à la mémoire qu’à la personnalité de Cherechevski. Il décrit cependant celui-ci comme « un être un peu lent, plutôt effacé », sans idée définie quant à son avenir, dont les projets étaient assez vagues. Il était en perpétuelle attente de quelque événement heureux qui apporterait une solution à tous ses problèmes, il passait plus de temps à rêver qu’à agir. Au terme de son observation, Luria constate qu’il « est resté tel un inadapté, après avoir tâté de plusieurs métiers qui, tous, n’étaient que des « provisoires » [102]. Cette description n’est pas incompatible avec un autiste de haut niveau, marié, avec deux enfants. Le plus surprenant est que Cherechevski « n’avait jamais rien remarqué de particulier en ce qui le concernait ». Constat qui laisse supposer l’existence d’un pôle invisible de l’autisme, non seulement pour les observateurs, mais pour certains sujets eux-mêmes.
Si l’on s’en tient aux critères de la psychiatrie moderne pour cerner ce pôle invisible il devient aussi incertain que la spécificité clinique de l’autisme pré-kannérien. Ainsi selon Ledgin et Grandin [103], attachés à l’approche du DSM-IV, nombre de célébrités devraient maintenant être considérées comme autistes, telles que par exemple T. Jefferson, A. Einstein, C. Darwin, O. Welles, Marie Curie, G. Mendel, B. Bartok, C. Sagan, G. Gould, W. A. Mozart, B. Gates, etc. Si l’on se satisfait du discernement de quelques traits dénotant des difficultés relationnelles et de la présence de « fixations ou de concentration suspectes », voire de « routines irrationnelles » ou d’attachement prolongé à des objets ; même en notant que beaucoup d’entre eux avaient un caractère « infantile », une apparence négligée, une mémoire étonnante, alors assurément une grande partie de l’humanité pourrait relever de l’autisme d’Asperger. Pourtant, à ne s’en tenir qu’aux quatre symptômes majeurs, solitude, immuabilité, troubles du langage, et précocité de la pathologie, le diagnostic n’est convaincant pour aucun des personnages cités plus haut. Bien que Ledgin évoque parfois les deux dernières caractéristiques, elles ne sont pas considérées par lui comme nécessaires au diagnostic. En fait son travail soulève une difficulté encore très peu étudiée : celle du diagnostic différentiel entre psychose ordinaire et syndrome d’Asperger. La question est d’importance car les incidences en sont majeures sur la conduite de la cure. Certes, il est rare que des autistes s’engagent dans une cure psychanalytique. Quand ils le font d’eux-mêmes, il s’agit presque toujours d’autistes Asperger ou post-asperger. Si l’analyste se laisse guider par le sujet, sans chercher à le précéder, il est immanquablement conduit par celui-ci à introduire le bord dans la cure, notamment par l’entremise d’objets et d’intérêts spécifiques. Il conviendrait qu’il sache comment composer avec eux, non pas en les interprétant, mais en encourageant leur décollement et leur développement ; cela jusqu’à produire une complexification du bord qui permet une mutation de l’intérêt spécifique en compétence sociale.
Le travail de Ledgin tend à une idéalisation de l’autisme qui rencontre aujourd’hui un écho favorable. Certains n’hésitent pas même à considérer que l’augmentation des autistes serait un espoir pour l’espèce humaine. Selon Mottron cette « modification spontanée du génome humain » produirait des avantages adaptatifs aux temps actuels. Elle se manifesterait « dans une compréhension intuitive des appareils et logiciels, dans l’apprentissage accéléré du code écrit, aussi bien que dans l’absence des mécanismes de contagion émotionnelle qui contribuent, entre autres, à la façon cruelle dont les non-autistes se traitent entre eux » [104]. Il n’est pas loin de considérer que l’autisme serait une mutation génétique liée à la sélection naturelle, de sorte que l’autiste serait un produit du monde moderne en voie d’une meilleure adaptation à celui-ci. En fait, la récente montée au zénith social de l’autisme s’ancre dans les affinités du fonctionnement de ces sujets avec les idéaux du discours de la science [105]. Les autistes de haut niveau se présentent comme des communicants non ambigus, disant toujours la vérité, et comme des êtres programmables, entièrement rationnels, qui apprennent tout par l’intellect, de sorte que nombreux sont ceux qui convoquent la métaphore de l’ordinateur pour s’appréhender. Ils annonceraient pour certains l’advenue d’un être de science débarrassé des « mécanismes de contagion émotionnelle ».
Le mode de fonctionnement des autistes de haut niveau parvient plus que tout autre à une maîtrise de l’objet perdu. En cela leur discours confine avec les idéaux de la science qui dans son approche de l’humain voudrait forclore la castration. Pourtant seule la prise en considération de leur mode spécifique de jouissance semble permettre de s’orienter dans la diversité clinique du spectre de l’autisme.
« L’homme pense avec son objet » [106] soulignait Lacan, commentant le Fort-Da freudien, l’autiste en a une intuition confuse, il devine même que de cet objet il faudrait s’auto-mutiler pour animer son être et réguler sa jouissance. Il parvient parfois à mimer cette coupure, mais elle reste maîtrisée, et donc toujours retenue. Les déplacements de l’objet autistique et les élections de différents doubles mettent en jeu un manque aussitôt effacé par la mise en place du nouvel objet ou du nouveau double. La source traumatique de l’intérêt privilégié se trouve gommée par l’aptitude de l’autiste à en devenir un spécialiste. Néanmoins il n’exclut pas la possibilité d’en apprendre plus encore, de sorte que cette compétence implique l’inhérence persistante d’une perte. D’où les ressources qu’il est parfois possible d’en tirer pour un exercice professionnel. « L’invention est le seul « remède » du sujet autiste, souligne E. Laurent, et elle doit, chaque fois, inclure le reste, soit ce qui demeure à la limite de sa relation à l’Autre : ses objets autistiques, ses stéréotypies, ses doubles » [107].
Les solutions autistiques les plus élaborées semblent se construire à partir d’une mutation de l’intérêt spécifique. Elles donnent naissance à la construction d’une « compétence » définie comme une combinatoire de signes maîtrisés propre à capter la jouissance. Les autistes-savants (prodigieux calculateurs, musiciens, dessinateurs, etc.) se caractérisent par la construction d’une compétence pauvre : elle ne fait guère lien social, mais elle mobilise les intérêts et les capacités du sujet, tandis qu’elle apaise ses comportements. Certains construisent des compétences constituées de mondes imaginaires dont les données sont déterminées avec précision afin de satisfaire leur volonté de maîtrise. Ainsi Gilles Tréhin a-t-il créé une ville imaginaire. Il a publié trois cents dessins la représentant, accompagnés de données historiques, géographiques, culturelles et économiques plausibles relatives à « Urville » [108]. Les autistes de haut niveau parviennent à l’élaboration d’une compétence plus achevée, qui fait lien social, construite en prenant appui sur leurs exceptionnelles capacités de mémorisation des signes. Ils deviennent alors des spécialistes reconnus d’un champ du savoir : informaticiens, mathématiciens, astronomes, etc. Il a fréquemment été constaté que les autistes de haut niveau exercent une profession dérivée des dites « obsessions » de leur enfance. La trappe de contention de Grandin, construite sur son bord, l’a conduite à devenir une universitaire spécialiste des trappes à bétails utilisés dans les abattoirs pour la mise à mort des bovins.
Ni la compétence, ni le bord ne s’interprètent, l’un et l’autre sont « désabonnés à l’inconscient », de sorte que nous touchons là une des raisons pour lesquelles les psychanalystes s’avèrent souvent embarrassés avec les autistes. Pour approprier la découverte freudienne à la spécificité de la structure autistique, il a fallu l’invention de « La pratique à plusieurs », et la modification de la conduite de la cure. Le « doux forçage » ne saurait passer, ni par des demandes directes, ni par des interprétations du passé, mais par une incitation au développement du bord. Que ce dernier se produise par sauts créatifs générés par l’assomption d’une perte rend l’approche psychanalytique incontournable pour s’orienter dans la cure de l’autiste.
J-C Maleval.
[1] Wing L. The relationship between Asperger’s syndrome and Kanner’s autism, in Frith U. Autism and Asperger syndrome. Cambridge University Press. 1991, pp. 93-121.
[2] Dovan J. Zucker C. Autism’s First Child. Atlantic Magazine. October 2010. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/10/autism-8217-s-first-child/8227/
[3] Dans la littérature psychiatrique internationale, le spectre de l’autisme s’est détaché de la clinique pour devenir un fourre-tout hétérogène fondé sur des similitudes comportementales. Selon le DSM-5, il inclut non seulement le Trouble autistique et le syndrome d’Asperger, mais aussi le Trouble désintégratif de l’enfance et le Trouble envahissant du développement non spécifié.
[4] Grandin T. Panek R. Dans le cerveau des autistes. [2013]. O. Jacob. 2014, p. 135.
[5] Lacan J. Discours de clôture des Journées sur les psychoses chez l’enfant. Quarto. 1984, 15, p. 30.
[6] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus. Robert Laffont. 1992, p. 20.
[7] Pour une analyse plus approfondie de la genèse du bord, qui crée initialement un espace subjectif homogène, sans trous, unilatère, sans limites, dont rend compte la topologie du plan projectif, cf Mouillac G. Topologie de l’autisme. Thèse de psychologie soutenue à l’Université Rennes 2 en 2014.
[8] Tustin F. Le trou noir de la psyché. [1986]. Seuil. Paris. 1989, p. 76.
[9] Ibid., p. 74.
[10] Ibid., p. 127.
[11] Dans les années 1990, Tustin a cherché à faire de la « mise en capsule autogénérée » la caractéristique majeure de l’autisme. [Tustin F. Autisme et protection. 1990] Seuil. Paris. 1992., p. 37].
[12] Laurent E. La bataille de l’autisme. Navarin/ Le champ freudien. 2012, p. 43.
[13] Kanner note une certaine fréquence d’un refus initial de nourriture chez les enfants qu’il a observé. « Donald, Paul, (« vomissaient beaucoup la première année »), Barbara ( « a été nourrie par sonde jusqu’à 1 an »), Herbert, Alfred et John ont présenté de grandes difficultés à être nourris depuis le début de la vie. La plupart d’entre eux, après une lutte sans succès, constamment gênante, abandonnaient finalement la lutte et, d’une manière soudaine, commençaient à manger d’une manière satisfaisante ». [Kanner L. Autistic disturbances of affective contact, Nervous Child, 1942-1943, 3, 2, pp. 217-230. Traduction française in Berquez G. L’autisme infantile. PUF. Paris. 1983, p. 257.
[14] Crespin G.C. La recherche PREAUT, in La Revue Lacanienne. Juin 2013, 14, p. 101.
[15] Laurent E. La bataille de l’autisme, o.c., p. 65.
[16] Grandin T. Penser en images. O. Jacob. Paris. 1997, p. 66.
[17] Bettelheim B. La forteresse vide. [1967] Gallimard. Paris. 1969, p. 264.
[18] Lefort R. et R. Naissance de l’Autre. Seuil. Paris. 1980, p. 273.
[19] Tustin F. Le trou noir de la psyché [1986]. Seuil. Paris. 1989, p. 30.
[20] Lemay M. L’autisme aujourd’hui. O. Jacob. Paris. 2004, p. 166.
[21] Laurent E. La bataille de l’autisme, o.c., p. 68.
[22] Tustin F. Autisme et protection. [1990] Seuil. Paris. 1992, p. 238.
[23] Elle utilisait ici le « tu » en place du « je » comme elle le faisait fréquemment.
[24] Tustin F. Autisme et protection. [1990]. Seuil. Paris. 1992, p. 77.
[25] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 303.
[26] Lefort R. et R. Naissance de l’Autre, o.c., p. 411.
[27] Williams. Quelqu’un, quelque part, o.c., p. 35.
[28] Bettelheim B. La forteresse vide, o.c., p. 285.
[29] Ibid., p. 277.
[30] Bettelheim B. La forteresse vide, o.c., p. 188.
[31] « Au dernier stade de cette évolution, note Bettelheim, elle déchirait le centre de la feuille de papier dès le début, le jetait, toujours avec une expression de dégoût, et alors seulement déchirait la feuille concentriquement en se dirigeant vers le centre maintenant vide. Il était impressionnant de constater l’adresse avec laquelle elle enlevait, apparemment sans effort, le centre exact de la feuille de papier et avec laquelle elle arrivait toujours exactement en cet endroit lorsqu’elle avait fini de déchirer » (Bettelheim B. La forteresse vide, o.c., p. 187)
[32] Bettelheim B. La forteresse vide, o.c., p. 190.
[33] Tustin F. Autisme et protection, o.c., p. 168.
[34] Laurent E. La bataille de l’autisme, o. c., p. 71.
[35] Tammet D. Je suis né un jour bleu. Les Arènes. Paris. 2007, p. 28.
[36] Laurent E. La bataille de l’autisme, o.c., p. 105.
[37] Ibid., p. 67.
[38] Ibid., p. 165.
[39] Ibid., p. 158.
[40] Brauner A. Les enfants des confins. Grasset. Paris. 1976, p. 80.
[41] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., pp. 76-77..
[42] Ibid., p. 76.
[43] Ibid, p. 78.
[44] Ibid., p. 23.
[45] « Papoose » est un terme utilisé par certains indiens d’amérique du Nord pour désigner le bébé.
[46] Attwood T. Le syndrome d’Asperger. De Boeck. Bruxelles. 2009, p. 201.
[47] Ibid., p. 212.
[48] « Parallèlement à la violence, écrit-il, j’avais découvert de nouveaux horizons musicaux, et la musique était devenue un jardin secret qui m’a certainement aidé à survivre ». [Ouellette A. Musique autiste. Triptyque. Montréal. 2011, p. 93. ]
[49] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 239.
[50] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 29.
[51] Ibid., p. 113.
[52] Axline V. Dibs. Développement de la personnalité grâce à la thérapie par le jeu. [1964] Flammarion. 1967, p. 197.
[53] Ibid., p. 199.
[54] Ibid., p. 210.
[55] Grandin T. Ma vie d’autiste. [1986] O. Jacob. Paris. 1994, p. 51.
[56] Ibid., p. 108.
[57] Cité par Laurent E., in La bataille de l’autisme, o.c., p. 73.
[58] Nazeer K. Laissez entrer les idiots. Oh ! Editions. 2006, p. 43.
[59] Ibid., p. 130.
[60] Ibid., p. 110.
[61] Ibid., p. 123.
[62] Gerland G. Une personne à part entière. AFD. Mougins. 2004, p. 232.
[63] Williams D. Everyday heaven. Jessica Kingsley. London. New York. 2004.
[64] Williams D. Quelqu’un, quelque part, o. c., p. 159.
[65] Williams D. Quelqu’un, quelque part, o.c., p. 143.
[66] Williams D. Quelqu’un, quelque part, o.c., p. 119.
[67] Ibid., p. 167.
[68] Ibid., p. 244.
[69] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus. [1992] Robert Laffont. Paris. 1992, p. 293.
[70] Ibid., p. 294.
[71] Ibid., p. 301.
[72] Harrisson B. L’autisme : au-delà des apparences. ConsulTED. Rivière du loup. Québec. Canada. 2010, p. 311.
[73] Asperger H. Les psychopathes autistiques pendant l’enfance [1944]. Institut Synthelabo. Le Plessis Robinson. 1998, p. 86.
[74] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 294.
[75] Damaggio N. Une épée dans la brume. Anne Carrière. 2011, p. 168.
[76] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 298.
[77] « J’élaborais à mon propre usage, rapporte Williams, toute une langue originale […] Parfois je tentais d’expliquer par tel geste ou telle mimique ce que je ressentais, mais le procédé était si subtil et si alambiqué que personne n’y prêtait attention à moins d’y voir la dernière excentricité de cette folle de Donna » [Williams D. Si onme touche, je n’existe plus, o.c., p. 55]
[78] Tammet D. Je suis né un jour bleu. [2006]. Arènes. 2007, p. 180.
[79] Hébert F. Rencontrer l’autiste et le psychotique. Vuibert. 2006, p. 208.
[80] Mouillac G. Topologie de l’autisme, o.c., p. 237.
[81] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 311.
[82] Tammet D. Je suis né un jour bleu, o.c., p. 35.
[83] Gerland G. Une personne à part entière. [1996] Autisme France. Mougins. 2004, p. 222.
[84] Ouellette A. Musique autiste. Triptyque. Québec. 2011, p. 28.
[85] Gilberg C. Préface à Gerland G. Une personne à part entière, o.c., p. 9.
[86] À l’exception cependant du travail de Elfakir A. Mémoire et autisme : de la neuropsychologie à la psychanalyse. Le cas de Cherechevski. L’information psychiatrique, 2005, 81 ; pp. 763-770.
[87] Tammet D. Embrasser le ciel immense. Les arènes. Paris. 2009, p. 90.
[88] Tammet D. Je suis né un jour bleu.[2006] Les arènes. Paris. 2007, p. 11.
[89] « Le cours de mes propres pensées, écrit Grandin, ressemble à celui décrit par A. R. Luria dans Une prodigieuse mémoire […] Tout comme moi, l’homme conserve une image visuelle de tout ce qu’il a lu ou entendu ». [Grandin T. Penser en images. O. Jacob. Paris. 1997, p. 27.]
[90] Williams D. Si on me touche, je n’existe plus, o.c., p. 133.
[91] Tammet D., o.c., p. 173.
[92] Nazeer K. Laissez entrer les idiots. Oh Editions. 2006, p. 26.
[93] Luria A. Une prodigieuse mémoire [1968], in L’homme dont le monde volait en éclat. Seuil. Paris. 1995, p. 235.
[94] Ibid., p. 280.
[95] Luria A., o.c., p. 258.
[96] Ibid., p. 277.
[97] Ibid., p. 237.
[98] Ibid., p. 300.
[99] Elfakir A, o.c., p. 768.
[100] Luria A., o.c. p. 299.
[101] Ibid., p. 304.
[102] Ibid., p. 303.
[103] Ledgin N. (Préface de T. Grandin). Ces autistes qui changent le monde. [2002]. Salvator. Paris. 2008.
[104] Mottron L. L’autisme : une autre intelligence. Mardaga. 2004, p. 206.
[105] Parmi les « Aspergers » connus, mentionnés par Tammet, beaucoup sont des scientifiques : « Richard Borcheds, professeur de mathématiques à l’Université de Californie (Berkeley), qui a reçu la médaille Field ; Vernon L. Smith, prix Nobel d’économie ; Bram Cohen, à qui l’on doit le programme informatique « BitTorrent » ; Dawn Prince-Hughes, docteur en philosophie, anthropologue et primatologue ». [Tammet D. Embrasser le ciel immense. Les arènes. Paris. 2009, p. 30].
[106] Lacan J Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Livre XI. Seuil. Paris. 1973, p. 60.
[107] Laurent E. La bataille de l’autisme, o.c., p. 65.
[108] Tréhin G. Urville. Carnot. Chatou. 2004.
 Écouter les autistes
Écouter les autistes